Certains jours de pleine lune, en la petite salle des Arts Contemporains du Musée des Beaux-Arts de Montréal, trois tableaux de l’exposition permanente prennent mystérieusement vie et discutent doctement et vivement d’art moderne. Ces figures tourmentées et très honorablement anthropomorphes, cultivées, omniscientes, pétulantes, astineuses, taquines, mutines, dialecticiennes et fort au fait de ce qui les déterminent sont (dans le désordre):

PORTRAIT DE SIR HERBERT READ (de Karel Appel)

LE MOUSQUETAIRE (de Pablo Picasso)

LA TÊTE (de Joan Miró)
.
Mais écoutons plutôt…
.
Portrait de Sir Herbert Read (de Karel Appel): Mes bons amis, vous y êtes. C’est la pleine lune. Y a plus personne dans le musée.
Le Mousquetaire (de Pablo Picasso): Présent.
La Tête (de Joan Miró): J’en suis.
Portrait de Sir Herbert Read: Bon. Mousquetaire, Tête, de quoi on parlait l’autre nuit?
Le Mousquetaire: Une seconde. Je proteste. On est une sale bande d’hidalgos hipophallocrytes. Y a que des mecs ici. C’est pas bien galant.
La Tête: Je suis une fille.
Le Mousquetaire: Tu dis?
La Tête: Que je suis une fille.
Le Mousquetaire: Ben dis donc. Ça se voit pas tout de suite à ta tête, Tête.
Portrait de Sir Herbert Read: Pas pour rien que son peintre s’appelle Miró. Hu, hu, hu, boutade argotique.
La Tête: Je suis un tableau surréaliste, tas d’andouilles. J’ai pas de modèle figuratif très précis. Alors la barbe. Vous savez pas reformaliser mentalement vos heurts artistiques mais vous savez encore parler, non? UNE Tête. LA Tête. Je suis une fille et tout est dit.
Portrait de Sir Herbert Read: Oui, oui. C’est bon pour moi. Quant au Mousquetaire, va falloir qu’il nous fasse confiance, là dessus. Il a pas les yeux en face des trous, le gars et ce, littéralement.
Le Mousquetaire: Oh, je suis un Picasso, Ducon. Alors il vous fait dire NOBLESSE OBLIGE, le gars bigleux en question.
La Tête: Je seconde le Mousquetaire là-dessus. Par contre Mousquet quand tu t’adresses au digne et altier Portrait de Sir Herbert Read, faut pas dire Ducon.
Le Mousquetaire: Ah non? Faut dire quoi alors?
La Tête: Durubicon.
Le Mousquetaire: Hu, hu, hu. Est bonne ta boutade, Tête.
Portrait de Sir Herbert Read: Je la saisis pas.
Le Mousquetaire: C’est parce que tu t’es pas vraiment vu, mon pauvre rubicon rageur. T’as le visage comme une de ces bouteilles de ketchup inversées à la mode qui reposent sur leur bouchon et ce, de forme et de couleur.
La Tête: Voilà, exactement. Regarde-toi, plutôt. Mate.
Portrait de Sir Herbert Read: Regarde-toi PLUS TOMATE. Ah, ah, ah, très drôle.
Le Mousquetaire: Je l’avais pas saisie. Oh, mais elle est une petite subtile, notre Tête.
La Tête: Je suis une fine bouche de tête. Et j’ai l’œil…
Portrait de Sir Herbert Read: Bon, euh… Mousquet, dis voir un peu… On continue de déconner ironico-dadaïste, en se marrant bien, entre copine et copains, comme ça, sous la lune, cons comme elle, ou on en revient à ta question de l’autre nuit?
Le Mousquetaire: Ah oui, Herbert! T’as tout à fait raison. J’aimerais bien qu’on y revienne.
La Tête: C’était quoi déjà ta question de l’autre fois, Mousquet?
Le Mousquetaire: Ben c’est à propos des ready-made. Tu vois bien ce que c’est les ready-made, oui?
La Tête: Les morceaux d’art trouvé.
Portrait de Sir Herbert Read: Les objets préexistants, habituellement industriels ou à tous le moins usinés, qu’on intronise comme art en les isolant sur un piédestal ou en les combinant entre eux, de façon souvent mutine, éclectique, ou spirituelle, ou tout simplement absurdiste.
Le Mousquetaire: Voilà. Et ma question c’était: comment on les limite?
La Tête: Pourquoi tu voudrais les limiter?
Le Mousquetaire: Bien parce que, bon, des millions d’objets usinés disponibles, des milliards de combinaisons possibles entre eux. Il y a de quoi perdre le contrôle des troupes, dans tout ça. On s’arrête où? On structure comment? On organise notre action de quelle manière?
Portrait de Sir Herbert Read: Venant d’un tableau d’un peintre aussi prolifique et débordant que Picasso, faut dire que ta question manque pas de piquant.
Le Mousquetaire: Oh, laisse un peu Picasso où il est. Je suis très fier de lui, certes, mais, aussi, je suis une œuvre autonomisée de son auteur, moi, gars. J’ai parfaitement droit à mes petites cogitations personnelles.
La Tête: Absolument, Mousquet. Ta question est légitime et, de fait, fort intéressante. Je dirais qu’avec les ready-made, faut PAS structurer ou organiser et surtout faut pas s’arrêter. Il faut laisser arrêt, organisation et structure s’imposer objectalement.
Portrait de Sir Herbert Read: Objectalement… Tu pourrais développer?
Le Mousquetaire: Qu’on s’instruise.
La Tête: Laisse aller tes combinaisons de ready-made. Vas-y. Fais-le monter en toi et prendre corps dans le monde, le torrent des combinatoires du préexistant. Excite-toi avec ton petit mécano préfabriqué. Et à un moment, le scotome va donner un coup d’arrêt objectal, et cristalliser de facto une structure qui, alors, s’imposera à toi.
Le Mousquetaire: Le quoi va donner un coup de… truc?
La Tête: Le scotome. L’image obsédante qui vide ton œil de toute autre chose. La hantise. La fixation.
Le Mousquetaire: Comme mettons… les bouvillons durillons chez Picasso, mon roi, mon peintre?
Portrait de Sir Herbert Read: Très bon exemple que les… euh… les taureaux de Picasso. Ou le petit personnage en gabardine chez Magritte, ou les grands hommes longilignes qui marchent de Giacometti, ou les immenses petits chiens sculptés dans des ballons oblongs de Koons.
La Tête: Voilà. Voilà. Les exemples sont innombrables. Enfin, tu connais nos peintres et nos sculpteurs, Mousquet. Des obsédés, des fixistes mono-orientés, des unaires à la lubie récurrente. Dans tes millions d’objets, tes milliards de combinaisons, ils vont toujours aller chercher la même marotte et la courber dans le même angle. Ne leur limite pas abstraitement, par avance, selon des règles convenues qui ne t’attireront que déconvenue, les combinaisons possibles des ready-made. Les limitations subjectives de l’artiste vont bien s’en charger pour toi, va.
Le Mousquetaire: Je ne vois pas de scotome ou d’entité récurrente dans les ready-made de Marcel Duchamp qui, pourtant, a, lui, proprement inventé le phénomène.
La Tête: Non, en effet. Et, de son aveu même, Duchamp a assez vite cessé de faire des ready-made. Ne sentant pas émerger de scotome structurant, il s’est tout simplement lassé du procédé, plus précisément de l’ennuyeuse puissance du procédé. Vieillots, classiques, un peu dépassés même, les ready-made de Duchamp ne tiennent aujourd’hui que dans une petite salle d’exposition. Les millions d’objets, les milliards de combinaisons se sont lassés en lui longtemps avant que de nous imposer le moindre débordement bringuebalant.
Portrait de Sir Herbert Read: Le scotome donc, c’est lui qui va stabiliser les options dans l’art trouvé. Je voudrais faire remarquer que ton observation sur l’engendrement objectalement circonscrit des ready-made, Tête, s’applique aussi parfaitement, et sans transposition particulière, dans l’art directement produit artisanalement ou reproduit en récurrence. Voyez le très libre Andy Warhol. Ses Marilyn, ses Elvis, ses Mao se démultiplient bien un peu, en jouant des variations ronéo-chromatiques d’un temps mais, ressources industrielles à part, tout finit bien par se fixer, se figer. La réponse à ta question, Mousquet, c’est bel et bien le scotome. Sauf que d’où il vient, lui, le scotome?
Le Mousquetaire: Oh, c’est une blessure, au départ. Comme un coup de fleuret qui aurait laissé sa trace, sa balafre de vie.
La Tête: L’image est badine, mutine, spadassine, mais vive et stimulante. T’es pas mousquetaire pour rien, ardent Mousquet. Mais poursuis plutôt.
Le Mousquetaire: Une blessure qui se fiche, se niche, s’imprime dans l’artiste. Une botte de Nevers semi-consciente qui se plante directement entre ses deux yeux. Et de par la susdite blessure fouaillante enfouie, l’artiste se met à configurer des gestes, des actes, des décisions, comme on décide de ne plus aller se promener en forêt par peur du loup qu’on a cru y voir et qui nous hante déjà. Et si «mon» mousquetaire a les deux yeux du même côté de la tête, il ne sera pas le seul. «Mon» œuvre de portraitiste sera traversée par la redite qui roule les yeux du même bord.
La Tête: Et la fixation devient formule, ritournelle, cheval de bataille, procédé, marque de commerce, hantise.
Portrait de Sir Herbert Read: Ouais… ouais… mais je vous trouve bien psychologisants tous les deux, avec ce genre d’analyse post-traumatique. Vous réduisez un peu les contraintes de production de l’art à un corps passablement riquiqui d’enjeux individuels solitaires.
Le Mousquetaire: Développe un peu ton idée, monsieur le portrait militant et rageur d’un éminent critique d’art anarcho d’autrefois…
Portrait de Sir Herbert Read: Bien pensez à Auguste Rodin au 19ième siècle, à Andy Wahrol au 20ième siècle, à Jeff Koons au 21ième siècle.
Le Mousquetaire: Bon, j’y pense.
La Tête: Moi aussi.
Portrait de Sir Herbert Read: Eh bien, les vastes entreprises artistiques de ces peintres et sculpteurs étaient ou sont de véritables ateliers de montage. Ce sont des ruches bourdonnantes, gorgées d’une nuée d’esprits créateurs en interactions au sein desquelles susdites ruches le caractère collectif de la production rend un peu difficile à défendre votre théorie du scotome sur œil unique faisant boitiller le corps individuel d’un éventuel artiste isolé dans ses bottes, toujours dans le même sens.
Le Mousquetaire: Attention, attention. Les mousquetaires vont par escadrons compacts. Mais ils obéissent pourtant, fidèlement, méthodiquement, à un commandement unifié.
Portrait de Sir Herbert Read: Oh, oh, tu vas pas me raconter que les mousquetaires au combat, dans le feu de l’action, ne prennent pas, par brassées, des initiatives tactiques qui, une fois la position convoitée conquise, voient une telle activité décisive de leur groupe ostensiblement approuvée et revendiquée par le commandement et ce, totalement après coup, vu leur succès.
Le Mousquetaire: Ce que tu décris existe, oui. Je dois l’admettre.
La Tête: Ce que tu nous dit, Herbert, c’est que, dans l’atelier du grand Rodin, se met éventuellement à remuer dans tous les sens une Camille Claudel dont les hantises et les marques de commerce ne sont pas nécessairement les mêmes que celles du maître.
Portrait de Sir Herbert Read: Voilà. Et alors, bon, eh bien, qui est Rodin, qui est Claudel? Qui fait quoi? Et finalement, l’un dans l’autre, quel est le statut artistique du grand atelier? Même sa structure autoritaire et dirigiste ne peut échapper au fait que fondamentalement l’art est collectif, tiraillé, contradictoire, fortuit, interactif.
Le Mousquetaire: Une seconde, une seconde… Dites-moi donc comment jaillissent des hantises individuelles, au sein d’un art qui, lui, est —me dites vous, à raison— une vaste action collective, coordonnée ou non, docile ou séditieuse, toujours un peu grognarde et subversive en fait, remuante, sémillante? C’est ça que tu demandes?
Portrait de Sir Herbert Read: Exactement.
La Tête: Bien, si l’art canalise une hantise, la hantise d’un temps, et que l’art est collectif, selon les modalités de production artistique et pratique d’un temps, y a alors qu’une seule explication.
Portrait de Sir Herbert Read: Laquelle?
La Tête: La hantise exprimée par l’art est, elle aussi, une hantise collective. La hantise collective d’un temps.
Le Mousquetaire: C’est… c’est assez plausible, ce que tu dis là, Tête. M’autorisez-vous, en me l’excusant, une autre analogie militaire?
La Tête: Tire toujours, Mousqueton.
Portrait de Sir Herbert Read: On t’écoute, canon de canons.
Le Mousquetaire: Herbert évoque les initiatives tactiques que doivent constamment prendre les sous-offs et la piétaille dans le feu concret de l’action. Bien vu. Mais la vrai force et le réel avantage d’une armée en campagne réside dans un autre important fait collectif: la réaction favorable des populations de l’hinterland local. Si ces populations se sentent envahies, ça va résister et ton armée va sérieusement pédaler dans la mélasse. Si ces populations se sentent libérées par l’armée qui s’avance, ça va exulter et les mousquetaires auront l’impression de voler sur l’horizon avec leurs capes, emportés qu’ils seront sur le dos et les épaules guillerets de l’hinterland.
La Tête: Et l’équivalent de ces populations de l’hinterland local dans la démarche artistique ce serait?
Le Mousquetaire: Le public, les groupes sociologiques qui découvrent l’art dans une phase historique donnée, l’avant-garde culturelle même, si elle a une force de frappe sociétale suffisante.
Portrait de Sir Herbert Read: Pas trop con, le Mousqueton.
Le Mousquetaire: Quand Braque s’est mis à dessiner des petits cubes, pour utiliser l’expression consacrée, dans un sens ou dans l’autre, tout le monde s’est braqué. Boutade mais vérité aussi. On aimait ou on détestait mais en tout cas le collectif des amateurs d’art contribua assez solidement à la hantise en cours de constitution.
La Tête: Et le scotome devint l’affaire d’un peu tout le monde, même dans le cas des non-peintres et des non-sculpteurs. Tout le monde se mit, assez subitement, à parler d’art abstrait.
Portrait de Sir Herbert Read: À raison dans le cas des Cubistes. À tort et à travers par la suite.
Le Mousquetaire: Pardon?
Portrait de Sir Herbert Read: Je dis: à raison dans le cas des Cubistes. À tort et à travers par la suite.
Le Mousquetaire: Explique-toi un peu, gars. Remarque, je le prends pas personnellement. Perso, je ne me considère pas comme un tableau cubiste sous prétexte que Picasso, peintre cubiste, m’a peint.
La Tête: Et sur cela, tu as parfaitement raison, Mousquet. Pour être cubiste, une toile doit incorporer des arêtes, des angles droits, des volumes géométriques, des cubes quoi, intégraux ou partiels.
Portrait de Sir Herbert Read: Voilà. Cubisme renvoie à certains tableaux faits par certains peintres, pas à ces peintres eux-mêmes qui, eux, avant ou après, pourront avoir exploré bien d’autres styles.
Le Mousquetaire: Exactement. C’est justement le cas de mon peintre, Picasso, pour ne pas le nommer encore, derechef, comme on le sait tous. Alors, bon, Herbert, dis-nous ce que tu voudras sur les tableaux cubistes. Tu ne me vexeras pas car je n’en suis pas.
Portrait de Sir Herbert Read: Entendu. Alors, suis-moi bien. Quand Braque peint ses fameuses maisons de l’Estaque, il rejette certains détails au profit de formes fondamentales qu’il choisit d’accuser, de mettre en relief. D’un groupe de maisons, il tire un amoncellement de cubes penchés ou droits, en gardant ce qu’il voit ou veut voir ou faire voir et en atténuant certains aspects de leur structure formelle. Que fait Braque de ces détails, aspects et facettes qui ne sont pas directement cubistes?
Le Mousquetaire: Sais pas. Dis toujours.
Portrait de Sir Herbert Read: Eh ben, il en fait abstraction, ni plus ni moins. Abstraire, tu vois, c’est quelque chose finalement d’assez ordinaire. C’est éliminer ou négliger les détails qui comptent moins pour la pensée du moment. C’est dire oiseau au lieu d’épervier, ou poisson au lieu de saumon, ou… cube au lieu d’immeuble. L’abstraction c’est une opération mentale que c’est pas du n’importe quoi, si je puis dire. C’est ça, sans moins, sans plus. Escamoter des détails choisis. Retenir un essentiel minimalisé.
La Tête: C’est très bon, ça, Herbert. Et, donc, alors, fatalement, selon ton raisonnement, moi, je suis une peinture abstraite. Me croyez-vous?
Portrait de Sir Herbert Read: Absolument. Tu es une tête esquissé qu’on ramène à sa substantifique forme de goutte ou de poire ou de grand faciès noir avec œil en forme de larme, au choix. Tu es le résultat indubitable d’une solide et originale abstraction picturale.
La Tête: Je ne te le fais pas dire, mon beau. Remarque l’abstraction ici vient aussi de mon titre, comme corrélation descriptive de mon jeu de formes.
Portrait de Sir Herbert Read: Tout à fait. Et le titre Tête est beaucoup plus abstrait, comme mot, comme notion, que, disons, le titre Portrait de Sir Herbert Read. Il est effectivement important de le noter.
Le Mousquetaire: Sauf que toi, dans ton cas, mon pauvre, l’empereur est nu.
Portrait de Sir Herbert Read: Qu’est-ce à dire?
Le Mousquetaire: Je sais pas si ça fait de toi une peinture abstraite ou quoi, mais tu ne ressembles AUCUNEMENT au Monsieur Sir Mister Herbert Read Sir de chair et d’os. Ça fait quasiment peur de voir comment t’es PAS un portrait, mon pauvre Herbert.
La Tête: Je suis obligée de seconder inconditionnellement cette observation de notre bon Mousqueton.
Portrait de Sir Herbert Read: Cela fait de moi moins une peinture abstraite qu’une peinture semi-figurative. Toi aussi, Mousquet, du reste, tu es une peinture semi-figurative. Tu es, certes, parfaitement conforme à ton titre, avec la barbichette cruciforme, l’allure fierette et la coiffure léonine là. Tu fais de plain-pied mousquetaire… mais pas que! La peinture la plus abstraite, au strict sens propre et adéquat du terme, ici, cette nuit, sous notre petite lune à trois, c’est Tête.
La Tête: Tout à fait. Oh yeah… On se refait pas, mes gars.
Portrait de Sir Herbert Read: Ceci dit, des tableaux semi-figuratifs comme moi ou Mousquet incorporent un certain élément d’abstraction imagière, comme le fait tout dessin, en fait. Simplement, et tout prosaïquement, on est pas ce qu’il convient d’appeler peinture abstraite.
Le Mousquetaire: Ben non. Surtout que ce qu’on appelle peinture abstraite usuellement c’est les travaux colossaux des Grands Barbouilleurs de N’importe Quoi qui t’éclaboussent les couleurs sur la toile en amenant brutalement et ardemment le tableau à représenter rien d’autre que lui-même sous forme de flots torrentiels de croûte épaisse et éclatante.
La Tête: Oui, oui… bon: Jackson Pollock, Jean-Paul Riopelle, Pierre Soulages et des tableaux de ton peintre Karel Appel autres que toi, Herbert.
Portrait de Sir Herbert Read: Oui. Mais voyez la foutaise en cours ici. Le sens commun du tout venant descriptif nomme abstraction ce qui n’est absolument rien d’autre que la souplesse et le relâchement concret des formes visuelles s’affranchissant enfin, joyeusement et subversivement, de toutes représentations figuratives.
Le Mousquetaire: Pardon? Les Barbouilleurs de Grand N’importe Quoi Non-Figuratifs Éclabousseurs de Croûtes en Déferlantes Polychromes font pas de la peinture abstraite?
Portrait de Sir Herbert Read: Non.
Le Mousquetaire: Il font quoi, alors?
Portrait de Sir Herbert Read: De la peinture informelle, mon cher bidasse de cap et d’épée.
La Tête: Oui Mousquet, oui, oui, c’est vrai. Appeler la peinture informelle de la peinture abstraite procède d‘une lancinante déviation figurativiste. Ça postule que toute peinture doit, comme par devoir, représenter quelque chose d’empiriquement visualisable, pesamment venu du monde. Quand on voit plus rien que des barbouillages, des poches chromatiques et des chocs colorés, on fourre tout ça sous l’étiquette peinture abstraite qui ainsi perd tout son sens. C’est pas là une description très adéquate de ce qui se passe.
Portrait de Sir Herbert Read: C’est pas là une description très honnête de ce qui se passe, même.
Le Mousquetaire: Bon, oublions les Grands Barbouillages. Ils sont pas une abstraction du monde. Ils sont juste… eux-mêmes. Sans plus.
La Tête: Bien dit. Ils transgressent ou ils décorent, point barre. Ils ne représentent pas, ne dépeignent pas.
Le Mousquetaire: Bon, j’arrive à voir ça. Alors, prenons l’affaire dans l’autre sens. L’art abstrait est donc fatalement au moins partiellement figuratif. Il y a de l’art PLUS abstrait, comme les cubes penchés de Braque comme maisons ou toi La Tête de Joan Miró comme tête. Il y a de l’art MOINS abstrait, semi-figuratif, comme Herbert et moi. L’abstraction, donc, ça se pondère.
La Tête: Oui. Remarque, toi et Herbert, vous incorporez de solides éléments de transgression du figuratif. Ça, je le vois autant dans tes yeux doux que dans le teint torride de notre bouillant Sir Read. Mais transgression n’est pas nécessairement abstraction. Il y a même des transgressions figuratives qui retournent vers la concrétude. Une concrétude cette fois imaginaire, délirante, affolante, biscornue.
Le Mousquetaire: Bon, bon. Transgression d’origine imaginaire ou non, il y a toujours une certaine abstraction dans la représentation. Mais, poursuivant maintenant ma route dans l’autre sens, je vous demande: l’art le moins abstrait possible, le plus gorgé de concret imaginable, ce serait quoi, alors?
La Tête: Bien, le ready-made!
Portrait de Sir Herbert Read: Et toc. Tu ramasses un objet du tout venant, intégral de concrétude usuelle ou industrielle. Titre, piédestal, institutionnalisation, consécration, muséologie. Et l’art concret est solidement niché au logis.
Le Mousquetaire: Nous revoici donc ramenés à ce fichu zinzin de ready-made, à ses irritantes potentialités infinies…
La Tête: À son implacable scotome restrictif, limitatif, étrangleur.
Portrait de Sir Herbert Read: Scotome produit collectivement par les hantises de tous les acteurs impliqués d’une phase historique donnée…
Le Mousquetaire: Qui, eux, pour rien arranger, dénomment tout n’importe comment, appellent l’informel de l’abstrait, l’abstrait du figuratif et Picasso, artiste polymorphe et foisonnant, dont je suis, rappelons-le modestement mais fièrement, l’une des très nombreuses œuvres, un peintre tout juste… cubiste.
La Tête: Et cela est fort beau mais aussi fort triste.
Le Mousquetaire: Mais, euh… le ready-made…
Portrait de Sir Herbert Read: Bon, dites… la boucle est un petit peu bouclée pour cette nuit, là, hmm… Et en plus, oh là là, le jour se lève déjà. Aussi, je sens que je vais procéder à l’appel de la fin de cette rencontre.
Le Mousquetaire: Bon, bon… entendu… Pas pour rien que ton peintre s’appelle Appel, toi, hu, hu, hu…
La Tête: Ultime boutade ironico-dadaïste.

LA TÊTE (de Joan Miró)

LE MOUSQUETAIRE (de Pablo Picasso)

PORTRAIT DE SIR HERBERT READ (de Karel Appel)
.
.
.










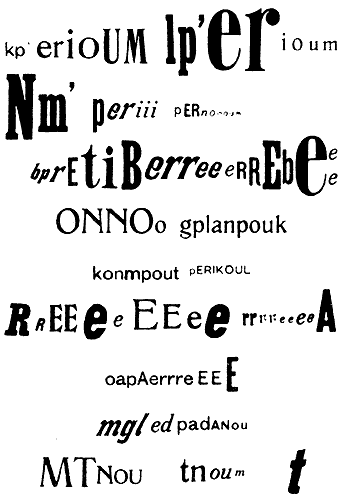























Hantise de l’interrupteur lumineux II (du nouveau sur les ready-made)
Posted by Ysengrimus sur 7 décembre 2018
Hantise de l’interrupteur lumineux II (photo: Source Vive)
.
Simplement prendre note que c’est un interrupteur lumineux, ou que c’était un interrupteur lumineux, qui a changé de destination, puis c’est tout.
(d’après Marcel Duchamp)
.
.
.
Mort il y a tout juste cinquante ans, Marcel Duchamp (1887-1968) continue de manifester sa présence aussi chafouine que lancinante et je voudrais ici en témoigner de par un charmant petit cadeau du Nouvel An qui me fut offert par ma nièce Iphigénie Civile, le 13 janvier 2018. Comme il s’agit encore de ces si obsédants ready-made, je vais me permettre de résumer le problème du jour à partir de quelques petites citations tirées de la remarquable vidéo À propos des ready-made (entretien de Marcel Duchamp avec Philippe Colin), du 21 juin 1967. D’abord que veut dire ready-made? Marcel Duchamp répond ainsi:
On retracera mes autres développements sur les ready-made ICI, ICI et ICI. Je veux pour le moment concentrer l’attention sur la dimension esthétique du problème qu’ils posent. Bon, en gros, on trouve des hélices, des soupapes, des roues de vélo ou des porte-chapeaux ici et là et on les investit directement comme objets d’art, en leur apportant peu ou pas de modifications. Cela se donne comme prosaïque, ironique, un peu frondeur mais compréhensible. L’objet trouvé qu’on a choisi devient art. L’option (qui a d’ailleurs eu un grand retentissement) semble au départ assez simple. Sauf qu’une autre radicalité est alors recherchée, beaucoup plus ardue, elle. Duchamp:
Sauf que là, ayoye, c’est toute ben juste pas faisable. Tous ces objets que Duchamp a investi comme ready-made sont aujourd’hui dans des musées du monde entier (habituellement sous forme de reproductions, les originaux étant souvent perdus). Et tout le monde se pâme sans fin sur eux, ou rage contre eux. Avec une certaine amertume aigre-douce, Duchamp était parfaitement conscient de la dimension quasi-insoluble de cet aspect anti-esthétisant du problème. N’importe quoi, vous savez, aussi laid que ce soit, aussi indifférent que ce soit, deviendra beau et joli après quarante ans, vous pouvez être tranquille. Alors, c’est très inquiétant, n’est-ce-pas, pour l’idée même de ready-made. (Marcel Duchamp dans À propos des ready-made — 4:46-4:57). Cette inquiétude philosophique est d’autant plus sentie du fait que, de par le ready-made, Duchamp souhaite, fermement et radicalement, faire disparaître complètement la sensibilité esthétique en art plastique, pour la remplacer par une sorte de froid constat factuel, post-industriel, neutre, libre de toutes les contemplations aimantes ou haïssantes. Vaste programme.
Pour ma part, je croyais dur comme fer que cette option anti-esthétisante de Marcel Duchamp représentait l’échec de la radicalité des ready-made. Je me disais: ti-père, au mieux tu es un grand naïf, au pire tu te fous ouvertement de notre poire, d’imaginer qu’un objet investi (par l’artiste, professionnel ou amateur) comme réalité non-utilitaire restera exempt de toute dimension esthétique. Juste: ayoye. J’étais certain que la mise sur l’axe beau/laid collait obligatoirement, comme effet fatal et conséquence inévitable, au halo sociologique de l’objet (artisanalement fabriqué ou ready-made) investi en soi, comme objet. J’ai donc cru en cet échec de Duchamp sur la dimension esthétique des ready-made, jusqu’en ce jour béni du 13 janvier 2018.
L’expérience que j’ai vécu en ce susdit 13 janvier 2018, dans des conditions parfaitement ordinaires (et très sympathiques) va profondément bouleverser les conclusions que j’avais précédemment mis en place dans mon esprit, sur cet échec qu’aurait subit Marcel Duchamp dans l’élimination de la dimension esthétisante du ready-made. Alors suivez bien le mouvement.
Une semaine plus tôt, le 6 janvier 2018, à la suite d’une première rencontre du Nouvel An, ma nièce, Iphigénie Civile m’annonce en catimini qu’elle aura un petit cadeau pour moi lors de la seconde rencontre du Nouvel An, celle du 13. Ce n’est pas un cadeau méchant et ce n’est pas un cadeau qui se mange. Touché et intrigué, je réclame qu’on me donne au moins un indice, histoire de me permettre de patienter, pendant cette longue semaine. Éminence des Fleurs (qui est visiblement dans la confidence), ma sœur et la mère d’Iphigénie Civile, me dit, sibylline: Relis un [de tes] vieux billet[s] de blogue. S’installe alors —et cela va prendre une grande importance dans la suite du développement— la réminiscence intertextuelle (si vous me passez le mot: c’est-à-dire le fait tout simple de s’ancrer dans un renvoi à un texte déjà écrit, que les personnes impliquées dans l’échange ont en commun comme objet de connaissance). Le blogue étant, par principe, un espace public, je suis forcé de postuler que les quelques 400 billets du Carnet d’Ysengrimus sont englobés dans cette insinuation de ma sœur. Je râle un peu, à cause de ce nombre (il m’est impossible de retrouver le billet auquel il est spécifiquement fait allusion) mais on ne me fournit pas d’indice plus approfondi. Et les choses en restent là, ce jour là.
Le 13 janvier 2018, le cadeau m’est remis par Iréné Lagare, le conjoint de ma nièce, en présence de cette dernière, de mon frère, de mes deux sœurs, et de tous les invités de cette petite rencontre. L’emballage du cadeau est intégralement (et inconsciemment) en ready-made. Il s’agit d’une de ces pochettes de Noël préfabriquées, qu’on utilise ou réutilise pour les petits cadeaux (on m’avoue même candidement qu’elle fait ici l’objet d’une de ces réutilisations). Les papiers décoratifs bouffants que l’on pose habituellement par-dessus le petit présent dormant au fond de la susdite pochette sont ici des pages de journaux, objet ready-made par excellence, s’il en est. Iréné Lagare me tendant le petit cadeau a même un peu des airs de Père Noël (je le lui signale gentiment, complétant tout naturellement le côté culturellement et préalablement codé du gestus). Il est important de faire observer que tout ceci s’est fait en pure spontanéité et sans aucune allusion à Marcel Duchamp ou à quoi que ce soit d’autre que l’unique source intertextuelle que l’on va bientôt découvrir (allusion formulée initialement le 6 janvier). Tout se joue ici dans des conditions parfaitement ordinaires. Quand ma nièce fronce le sourcil devant cet emballage cadeau semi-improvisé, son conjoint explique qu’il manquait de temps et a du faire avec ce dont il disposait. Et, bon, ça passe. Nous sommes ici dans tout, sauf la lourdingue pâmoison culturelle ou artistique. Dans la spontanéité du mouvement en cours, ces gens ne se prennent aucunement pour des personnages du film Les amours imaginaires de Xavier Dolan, si vous voyez ce que je veux dire.
Je soupèse délicatement le petit cadeau, sans le secouer. Il est léger. Je retire les papiers journaux et m’amuse à les rendre à ma nièce, comme s’ils étaient des documents d’importance. Je déniche finalement, au fond de la pochette cadeau, le petit interrupteur lumineux dont vous voyez la photo au haut de ce billet. Surprise totale et jubilation sentie. Vérification faite ipso facto, il s’agit d’un interrupteur antique dont, crucialement, le déclic est audible. Iphigénie Civile et Iréné Lagare l’ont délicatement recueilli pendant qu’ils procédaient aux rénovations intérieures de leur petit apparte montréalais, datant lui-même de l’époque de l’immédiat après-guerre. Il est alors limpide, pour toutes les personnes présentes, que ceci est une allusion directe au billet de blogue intitulé Hantise révolue de l’interrupteur lumineux (voir notamment le commentaire 10 sous ce billet, qui rapporte à chaud l’événement décrit ici). Comme ce billet fait référence à des souvenirs familiaux, je l’avais posté sur le groupe Facebook secret de ma famille et il a visiblement inspiré ma nièce, lors de ses activités de rénovation domiciliaire.
Arrêtons-nous un instant à l’objet même. S’il est difficile de parler ici d’Art Trouvé (formulation française parfois utilisée pour traduire ready-made — le caractère artistique de l’objet est problématique), il est indubitable que ce petit cadeau est un objet qui est à la fois tout fait et trouvé. Il se qualifie donc parfaitement comme ready-made au sens purement duchampêtre du terme. Là où notre affaire prend tout son sel, c’est qu’à aucun moment dans le processus, aucune des personnes impliquées (notamment les trois donateurs du présent, instigateurs inconscients mais effectifs de son nouveau statut de ready-made) ne se sont engagées sur la voie d’une démarche esthétisante. Personne ne s’est dit que cet objet était joli et que je le poserais sur un espace décoratif… ou qu’il était affreux et qu’en ma qualité d’iconoclaste artistique impénitent, je serais pleinement satisfait de sa hideur. L’objet ici est tout simplement ni beau ni laid et il n’est pas investi comme réalité esthétique ni, du reste, comme réalité utilitaire. En toute spontanéité et sans même que quiconque essaye d’y arriver, la partie la plus ardue du programme de Marcel Duchamp en matière de ready-made vient donc de se réaliser, sous nos yeux, comme si de rien. Investi en présent du Nouvel An, emballé dans un dispositif reçu culturellement l’encodant imparablement comme cadeau (dispositif d’emballage parfaitement ready-made, lui aussi, et ne faisant, lui non plus, l’objet d’aucune émotivité esthétique particulière), cet interrupteur ni beau ni laid, est, un point c’est tout.
La réaction immédiate du tout venant face à ce petit événement a perpétué, toujours sans que qui que ce soit (surtout pas moi) n’y fasse référence, le programme duchampêtre. Entre alors en scène mon frère Coupe-Feu-de-Choc. Il va avancer un certain nombre d’observations parfaitement éclairantes et intéressantes procédant de l’histoire ou de l’ethnologie des technologies. Ainsi, il fait observer que le boîtier de l’interrupteur est en céramique (les boîtiers des interrupteurs modernes sont en métal) et qu’il ne porte aucun numéro de série ou d’identification d’aucune sorte. Ces deux faits confirment le caractère parfaitement archaïque, peut-être même artisanal, de l’objet. Iréné Lagare en fera jouer le dispositif, attirant notre attention sur le fait que la structure interne du mécanisme de la switch est ancienne aussi, et n’existe plus dans les interrupteurs modernes, sous cette forme. Ma sœur Source Vive va même me faire prendre la pose pour tirer une photo de l’objet (c’est la photo supra — son titre est désormais Hantise de l’interrupteur lumineux II). De tous ces commentaires, interventions, observations et analyses, il n’émanera absolument aucune conception concernant l’éventuel beauté ou laideur de l’objet. Il est, un point c’est tout, ni beau ni laid, tout fait. Son impact mental est plus intellectuel qu’émotionnel. Il intéresse mais il n’exalte pas esthétiquement, ni dans une direction (beau) ni dans l’autre (laid). Non, mort de ma mort, Marcel Duchamp n’est pas mort.
Si bien qu’il y a lieu de se demander, l’œil glauque, ce qu’Iphigénie Civile vient de me donner là, finalement. Ce n’est pas un objet utilitaire (il est indubitable que je ne vais pas installer cet interrupteur dans mon bureau). Ce n’est pas un objet artistique (je ne vais pas l’encadrer ou le poser sur un socle, non plus). Qu’est-ce que c’est que ce truc, exactement? C’est pas si trivial, quand on s’arrête à y penser. Le problème n’est pas tout de suite évident. Et, dans ces conditions de réalisation concrètes et effectives de l’intégralité du programme des ready-made duchampêtres (prendre conscience de l’existence d’un objet tout fait sans qu’une visée esthétisante ne fasse jamais partie de l’équation), les faits effectifs nous fournissent (pour le moment) le constat qu’il n’a pas été possible de procéder à cette installation à vide. Évacué l’objet utilitaire, évacué l’objet esthétique, reste (et ça, Duchamp n’y avait pas pensé) l’objet réminiscent. Ma nièce ne m’a pas donné, comme ça, dans le vide, un vieil interrupteur lumineux pas rapport (comme on dit par chez nous), arraché d’un mur vermoulu, aléatoirement, parmi tant d’autres scories. Elle me l’a sciemment donné par allusion à un texte que j’avais préalablement écrit au sujet des vieux interrupteurs au déclic audible de jadis se trouvant dans une maison où elle a elle-même vécu des portions importantes de sa propre enfance. L’objet ne produit plus sa fonction (utilitaire). Il ne produit pas une exaltation (esthétique). Il produit une allusion (intertextuelle). La jubilation de cette allusion est intégrale, certes, mais elle n’est ni fonctionnelle ni artistique.
Sauf qu’elle n’est pas dans le vide non plus. L’espoir duchampêtre de dévider l’objet tout fait de toute détermination est encore toujours un petit peu raté. Il y a un truc, ni plus ni moins. C’est la réminiscence qui occupe la place que n’occupe pas (plus!) la dimension utilitaire, et pas (pas encore?) la dimension esthétique. En remerciant chaleureusement Iphigénie Civile et Iréné Lagare pour ce cadeau, je l’ai qualifié de magnifique (Je reprends d’ailleurs ce qualificatif dans le commentaire 10 du billet sur la hantise de l’interrupteur lumineux). Je suis donc le premier à faire référence à une éventuelle beauté de cet objet. Il s’agit, je m’empresse de le signaler, d’une beauté toute abstraite, toute philosophique, source d’une joie vive de voir Marcel Duchamp avancer d’un autre cran dans la sensibilité émotionnelle et factuelle de nos civilisations industrielles et post-industrielles.
Encore merci à toutes les personnes impliquées dans ce savoureux événement. Elles ont confirmé, si nécessaire, que les petites choses importantes se jouent souvent sans trop y penser… comme en se jouant, justement.
Marcel Duchamp (1887-1968)
Posted in Citation commentée, Civilisation du Nouveau Monde, Commémoration, Monde, Philosophie | Tagué: art, art contemporain, art moderne, art trouvé, arts plastiques, Éminence des Fleurs, beauté, cadeau, Coupe-Feu-de-Choc, esthétique, ethnologie, interrupteur lumineux, Iphigénie Civile, Iréné Lagare, Marcel Duchamp, Montréal, Nouvel An, objet d’art, objet esthétique, objet trouvé, objet utilitaire, Philippe Colin, Philosophie, Philosophie des arts, ready-made, Source Vive | 25 Comments »