
Don Camillo (Fernandel) et Peppone (Gino Cervi)
.
Il y a soixante-dix ans (en 1952) s’amorçait le très populaire cycle cimématographique de Don Camillo, mettant en vedette Fernandel (dans le rôle de Don Camillo) et Gino Cervi (dans le rôle de Peppone). Le canon (si on me passe le mot) des films incorporant ces deux personnages tels que joués par ces deux acteurs est: Le petit monde de Don Camillo (1952), Le retour de Don Camillo (1953), La grande bagarre de Don Camillo (1955). Don Camillo Monseigneur (1961) et Don Camillo en Russie (1965). Ces deux personnages du notable laïc et républicain (ou communiste) et du curé réactionnaire et irrationaliste (ou légitimiste) se chamaillant sans fin, parfois de façon stérile parfois de façon un petit peu plus féconde, pour l’influence et l’ascendant sur une commune de province ont au moins un duo de grands ancêtres. En effet, dans Madame Bovary de Gustave Flaubert (1857), l’abbé Bournisien et le pharmacien Homais, deux notables en vue de la commune fictive de Yonville, nous servent un peu la même mixture interactive, avec des résultats tout aussi incertains. Et il en existe d’autres exemples. Mais il reste que Don Camillo et Peppone ont porté ce dualisme taquin et railleur de la lutte des classes au niveau éthéré d’un grand stéréotype culturel. À mesure qu’il rapetisse tout doucement dans nos mémoires, tout le siècle dernier, en fait, s’y encapsule.
Don Camillo et Peppone sévissent eux dans la commune italienne bien réelle de Brescello. Leur interaction se joue principalement entre 1943 et 1963 (du temps de la Résistance au temps de la Détente). Ici, juste ici, dans le petit monde d’Ysengrimus, leur échange se veut indissolublement intemporel. Ils sont silencieusement revenu dans leur pays, entre la rivière et la montagne, le temps d’une dernière passe d’arme savoureusement ambivalente, enchevêtrant, comme toujours, le vouvoiement et le tutoiement, la complicité et la lutte, la ferveur bouillante et le calme olympien…
.
Don Camillo, curé de Brescello: Monsieur le maire?
Giuseppe Bottazzi dit Peppone, maire de Brescello: Monsieur le curé?
Don Camillo: Qu’est-ce que vous fichez-là?
Peppone: Mais… je vous renvoie la question, mon archiprêtre.
Don Camillo: Je ne le sais pas trop, pour le coup. Mais, ouf… as-tu vu la date en entête de cette feuille? Quinze janvier de l’an de grâce 2022.
Peppone: Y a pas… c’est passablement futuriste et moderniste comme date.
Don Camillo: Il n’y a pas de doute possible. Nous voici au paradis.
Peppone: Oh dites. Vous n’allez pas encore vous mettre à me ressasser vos légendes réactionnaires. Il n’y a absolument aucune preuve de ce que vous affirmez.
Don Camillo: Doux seigneur Jésus, expliquez-lui une bonne fois que nous sommes en paradis.
Voix de Jésus: Ne me mêle pas à tout ceci, Don Camillo.
Don Camillo: Mais seigneur… tout de même…
Peppone: Vous continuez d’entendre des voix dans le jubé bringuebalant de votre caboche, mon archiprêtre?
Don Camillo: Oh toi, de voix, tu es sur le point d’en entendre une aussi, tiens, celle de ta conscience, et nulle autre. Mais… mais… parlant de conscience. On dirait que la mienne s’élargit soudainement.
Peppone: La mienne aussi. Toutes les informations historiques se tenant entre 1962 et 2022 défilent en rafale dans ma tête. Soixante ans d’histoire viennent de débouler tapageusement sur le tambour de ma mémoire, d’un seul bloc.
Don Camillo: Moi aussi. Oh, oh… Effondrement et démantèlement de l‘URSS et de tout le bloc de l’Est, à partir de 1991. Mais c’est extrêmement intéressant.
Peppone: Montée en force de l’athéisme et déréliction généralisée dans toutes les cultures de la terre. Très intéressant. En effet.
Don Camillo: Oh, monsieur le maire. Voyez-vous ce que je vois, à travers tout ce tourbillonnant bazar socio-historique? Il y a une statue en bronze de vous grandeur nature dans une rue de notre belle petite commune de Brescello.
Peppone: il y en a aussi une de vous, mon archiprêtre. Mais c’est charmant et pittoresque tout plein.
Don Camillo: Oui, oui… Je vois la mienne, maintenant aussi, oui. Elle est bien mieux que la vôtre. Je suis mille fois plus ressemblant.
Peppone: Chacun son opinion.
Don Camillo: Sinon, ils sont drôlement vêtus, nos petits compatriotes de Brescello, tu ne trouves pas, Peppone?
Peppone: Oh que si. Mais pourquoi ils parlent tous d’un air pensif dans cet étrange talkie-walkie vitré, sans antenne. Ils en ont tous un.
Don Camillo: C’est pas un talkie-walkie, dis, patate. Regarde-les plus attentivement. C’est un petit appareil photo.
Peppone: Mazette. Il me semble bien que c’est un peu les deux. Qu’est-ce que c’est que ce monde?
Don Camillo: Je ne le sais pas du tout. En tout cas, ma belle petite chapelle, elle, elle est toujours à sa place. Mais elle me semble bien vide et désâmée.
Peppone: Pas la moindre insigne, affiche ou bannière avè le marteau et la faucille.
Don Camillo: Mais qu’est-ce que c’est que cette époque?
Peppone: Oh… on… on me fera quand même pas croire qu’une réalité aussi fondamentale et universelle que la lutte des classes est disparue. Té, je sens qu’on nous cache quelque chose, dans ce petit monde d’ici et de maintenant.
Don Camillo: Dieu aussi est une réalité universelle, mon bon ami. Qu’on ne vienne pas nous chanter qu’il n’existe plus ou, pire, qu’il est mort ou quelque fadaise dans le genre. Je ne marche pas.
Peppone: Oh mademoiselle! Vous pouvez m’indiquer ou se trouve le secrétariat du parti?
Don Camillo: Voulez-vous venir vous confesser? Hé?
Peppone: Ils ne nous entendent pas.
Don Camillo: Nous sommes comme des fantômes.
Peppone: Nous sommes des statues qui ne sont plus que de pâles spectres investis de vagues visées touristiques, sous notre beau soleil éternel.
Don Camillo: Ah, ben dis donc. Ça valait bien la peine de se polochonner comme on l’a fait, pendant toute cette éternité de vingtième siècle, té.
Peppone: Vous me le dites. On dirait que nos enjeux font ici figure de réminiscence en perte accélérée de densité.
Don Camillo: Ah, triste époque, va. Pauvre jeunesse d’un siècle nouveau.
Peppone: Luttes oubliées. Peine perdue.
Don Camillo: Ça me rappelle terriblement quand j’étais devenu Monseigneur et que tu étais devenu Sénateur. Tu te souviens?
Peppone: Eh comment. On trônait tout les deux comme des coqs en pâte à Rome et on se barbait pour mourir. On ne reprenait vie que quand on revenait au pays. Et surtout, par-dessus tout, quand je vous servais une bonne empoigne pour vous remettre votre petite mauvaise foi bien à sa place.
Don Camillo: Oh dis. Tu ne te présentais sous mon nez froncé que flanqué de ta bande de serviles malabars rouges. Tu n’as jamais osé affronter ma modeste personne seul à seul, d’homme à homme.
Peppone: C’est que vous étiez pas un homme, vous étiez un curé. Vous aviez toujours votre maudit Jésus en croix au fond de la chapelle, et qui servait de faire-valoir à votre très élastique conscience.
Don Camillo: Oh… Hé… Maudit Jésus en croix… Soit poli si t’es pas joli, là, Peppone.
Peppone: Euh… tu as un petit peu raison, quand même, pour le coup. Pardon Seigneur.
Don Camillo: Il ne te répondra pas. Il ne parle que dans le jubé de ma caboche, comme tu dis.
Peppone: Hé bé… on a la tête qu’on a, hé.
Don Camillo: Oh, dites, monsieur le maire. Vous la rameniez moins ces fois ou, nuitamment, en vous cachant soigneusement de vos camarades du parti, vous veniez brûler des cierges gros comme des troncs d’arbres, pour prier notre Jésus en croix, justement comme vous dites, de vous faire remporter une de vos satanées campagnes électorales.
Peppone: Et alors? Vous vous êtes bien commis une ou deux fois pour la cause prolétarienne, vous. Alors, moi, j’avais bien droit à mon petit zeste de religion.
Don Camillo: Commis avec la cause prolétarienne, moi?
Peppone: Oui, oui, vous. Parfaitement. On vous a pris à maintes reprises en flagrant délit, défendant ardemment les travailleurs agricoles pauvres contre les propriétaires fonciers qui les exploitent. Vous oseriez le nier?
Don Camillo: Non, je ne le nie pas. Mais j’œuvrais alors au nom de la charité chrétienne.
Peppone: Oh, elle a bon dos, la charité chrétienne.
Don Camillo: Le bolchevisme aussi, il a bon dos, mon cher. Ose dire que tu ne t’es pas rendu compte, notamment lors de notre fameux voyage commun en Russie, qu’il avait passablement de vodka dans son gaz, ton cher bolchevisme.
Peppone: Té, de la vodka mélangée adéquatement avè du gazole, cela pourrait faire un combustible moderne aux effets surprenants. Ils nous indiquent toujours un peu la voie, nos camarades russes.
Don Camillo: De bien brave gens, ces Russes, dans le fond. Ce fut un bien beau voyage que celui-là, hein, Peppone.
Peppone: Passablement oui. Formateur et utile, en tout cas. On a eu de beaux moments, ensemble, finalement, vous et moi, depuis notre première rencontre en 1943, dans la Résistance.
Don Camillo: Que veux-tu, mon brave Peppone. Faire la synthèse d’un siècle en l’entortillant sans trop faire de manières dans de la vis comica, cela ne peut pas laisser indifférent les acteurs en goguette qui s’y adonnent.
Peppone: Ah, oui. Il faut ben l’admettre tout de même.
Don Camillo: Viens, mon bon Peppone. Je suis certain qu’il me reste une ou deux modestes burettes d’un vin ancien, devenu aussi fantomatique que toi et moi, tout au fond de ma vieille sacristie. Je t’en offre une petite lampée, en souvenir du bon vieux temps.
Peppone: Ben, c’est pas de refus, Don Camillo.
.
Et les voici qui se mettent tout doucement en marche. Et ils coulent comme la rivière, quand elle se met elle aussi tout doucement en marche entre les montagnes, sous le soleil, vers la mer. Des histoires vraies se transforment alors en narrations fictives, des narrations fictives se transforment alors en histoires vraies, tandis que le mouvement de la susdite rivière tourbillonne en silence, pour aller ne se dire qu’à la mer. Et Don Camillo et Peppone, continuent, encore un temps, de marcher, en noir et blanc (on ne s’est pas encore avisé de les coloriser). Chacun d’eux se tient de sont côté de la route, allant son train de Sénateur et/ou de Monseigneur. Ils argumentent tapageusement, avec force gestes muets, tout en continuant de s’avancer ensemble vers quelque chose ressemblant incroyablement (il ne faut pas trop le leur dire) à une direction commune…




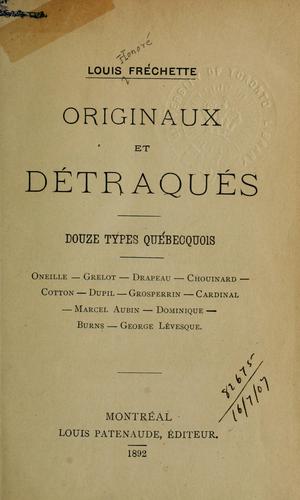
OCCUPONS MONTRÉAL — RÉFLEXIONS (John Mallette)
Posted by Ysengrimus sur 7 janvier 2022
Que reste-t-il, quelques dix années plus tard, du recueil de poésie militante qu’avait concocté John Mallette dans la mouvance des Carrés Rouges et du Mouvement des Indignés de 2012? Subdivisé en dix parties (Le rêve, La guerre, Camping citadin, Le présent, La Bourse, Démocratie, Religion, Médias, Grève des étudiants, Épilogue), ce court recueil de quatre-vingt-deux poèmes exprime les émotions et les réflexions d’un militant ordinaire, parfois perplexe, parfois timoré, souvent révolté, rarement survolté. Ancien ouvrier d’usine (ferblantier) et militant syndical, John Mallette est désormais homme de lettres dans la couronne nord de Montréal. Le tout de sa réflexion globale, il s’en faut de beaucoup, n’est pas exempt de sagesse sociale.
D’abord, bon, le recueil touche incontestablement le sujet qu’il annonce, l’occupation de Montréal par les Indignés de 2012.
.
La concrétude habite profondément l’évocation. La conscience est bien là au sujet de ce qui est difficile, de ce qui requiert effort et persévérance, de ce qui traîne derrière soi, comme des casseroles. C’est que le militant n’est ni rêveur, ni juvéniliste, ni triomphaliste. Il sait parfaitement que son action opère au sein d’un ensemble circonscrit de strictes et dures limitations d’époque.
.
C’est vu. C’est dit. Les symboles de la puissance bourgeoise arrogante et braquée ne bronchent pas. Les manifs, les chahuts, les charivaris, les tintamarres tonnent puis, fatalement, diminuent, s’esquivent, se perdent. Ils ne suffisent pas. Le poète militant le sait… il manque quelque chose.
.
En attendant ainsi la radicalisation des choses, l’acteur côtoie patiemment l’observateur. Le fait d’être un demi-combattant oblige, comme langoureusement, à se faire aussi demi-témoin. La révolte contenue, c’est toujours un peu le petit mal, ou un éternuement qui ne sort pas vraiment. Ainsi, le militant observe son espace. Plein de choses s’y passent, dans l’organisation comme dans la spontanéité du mouvement. Il remarque alors que, par exemple, les enfants ne décodent pas nécessairement l’activité d’occupation comme il le fait lui. La gué-guerre infantile, elle, elle traîne partout. Elle rode.
.
Le rendez-vous n’est alors pas raté avec l’opportunité, pour le poète militant, d’amplifier la réflexion, de se dégager de la praxis ocularisée et cernée du moment, et d’exprimer sa vision générale de la guerre, du bellicisme d’affaire et du cynisme froid les enrobant médiatiquement.
.
Il ne s’agit pas de se lamenter stérilement en pleurnichant contre les conflits de théâtres. Il est plutôt question de mettre solidement en connexion conflits, propagande, affairisme, cynisme bourgeois et perpétuation des soumissions. Et le poète élargit inexorablement son regard critique au sempiternel discours médiatique.
.
L’image est flétrie. Le rire est vicié, intoxiqué. Il grince. C’est d’ailleurs un clown casqué qu’on retrouve sur la page couverture du recueil de John Mallette. On ne croit pas au rire stipulé par contrat social. Il y a toujours quelque chose qui cloche, quand on laisse passer les clowns… surtout les clowns orateurs. Et de là, graduellement, la voix du poète militant s’ouvre sur les vicissitudes et turpitudes infinies de la politique politicienne.
.
Politisé, aseptisé, cerné, le simple citoyen perd ses repères. Et, entre deux poussées de fièvre protestataire, il redevient apathique. Il s’isole, se désole, retourne sautiller dans sa cornu. Il y stagne, s’y concocte. Le citoyen tertiarisé contemporain est en fait abandonné à la cage de verre qui l’enserre et hors de laquelle nulle voix ne le rejoint vraiment.
.
On ne sait plus que faire. La vague retombe. La dépression revient. Et, frustration… rien ne semble avoir vraiment bougé. L’intangible dicte sa lourdeur au mouvant qui, pourtant, s’annonce, même à perte, à lourdes pertes. Éventuellement, Montréal n’est plus occupé. Les gratte-ciels perdurent, immobiles, roides et glacés. Que faire? S’esquiver? Oh, la fuite hors de l’urb et de son inconscience dépersonnalisée ne donnerait rien de plus. En Canada, ce serait pour aller se taper la margoulette sur les perversités veules et secrètes du néo-colonialisme économico-régional le plus rapace imaginable.
.
Le nord est cerné, le sud est englué, l’est et l’ouest perdent leurs repères autant que leurs distinctions. Le monde est cybernétisé, cyberNETisé. Il n’y a pas de sortie, pas d’esquive, pas de défense assez solide pour perpétuer l’intégrité de l’être. C’est que tout s’engouffre dans cette satané fissure pseudo-leonardcohenesque.
.
Le troisième œil a indubitablement un pieu dans le front. Il n’est nullement et aucunement la solution. Le poète militant, malgré tout et bon an mal an, accède à une dimension philosophique. Mais cette dimension procède bel et bien du matérialisme historique. Le penseur fourbu entre en poésie concrète, dictant la fatale exigence d’une appropriation enrichie de la radicalité de l’étant.
.
Tout se dit et tout se dira. Rien n’est réglé, il faut encore et encore refaire la vie, et un autre jour viendra. Ah, bondance… il est assez indubitable que le titre choisi en 2012 pour ce dense recueil de poésie militante le sert assez mal, à terme. On retrouve en ces textes vifs et fulgurants un ensemble de développements d’une très grande validité, au sein du tonnerre de la réflexion de critique sociale contemporaine. N’enfermons pas ce précieux recueil de John Mallette dans une actualité anecdotique, restrictive et circonscrite. Rendons-le fougueusement à l’historicité plus ample dont il est tributaire.
Posted in Citation commentée, Civilisation du Nouveau Monde, Culture vernaculaire, Fiction, Lutte des classes, Monde, Montréal, Philosophie, Poésie, Québec, Vie politique ordinaire | Tagué: Canada, capitalisme, Carrés Rouges, fiction, francophonie, Histoire, Indignés, John Mallette, militantisme, Montréal, Occupons Montréal Quelques réflexions, Philosophie, poésie, protestation citoyenne, Québec, socialisme, société | 14 Comments »