





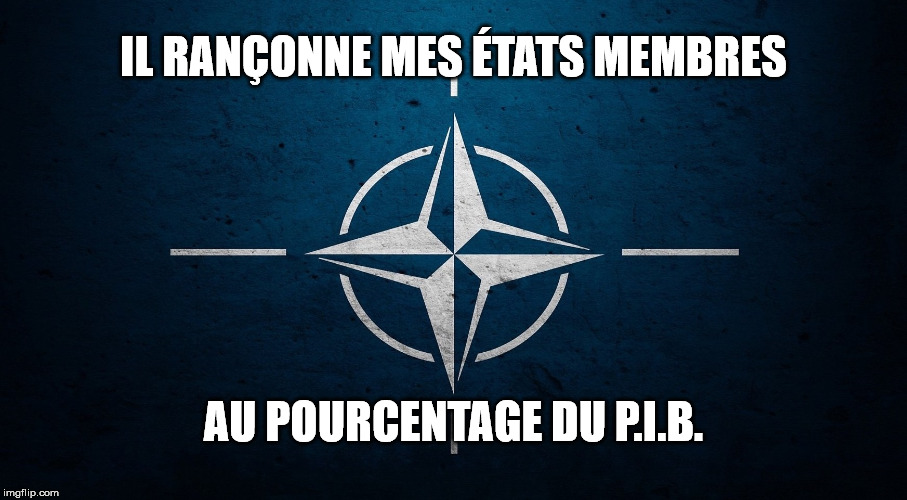


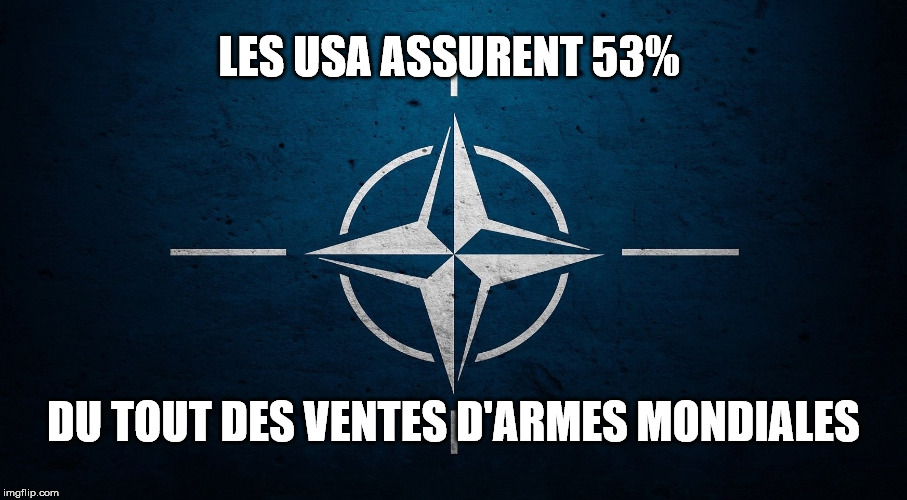


Posted by Ysengrimus sur 15 avril 2024






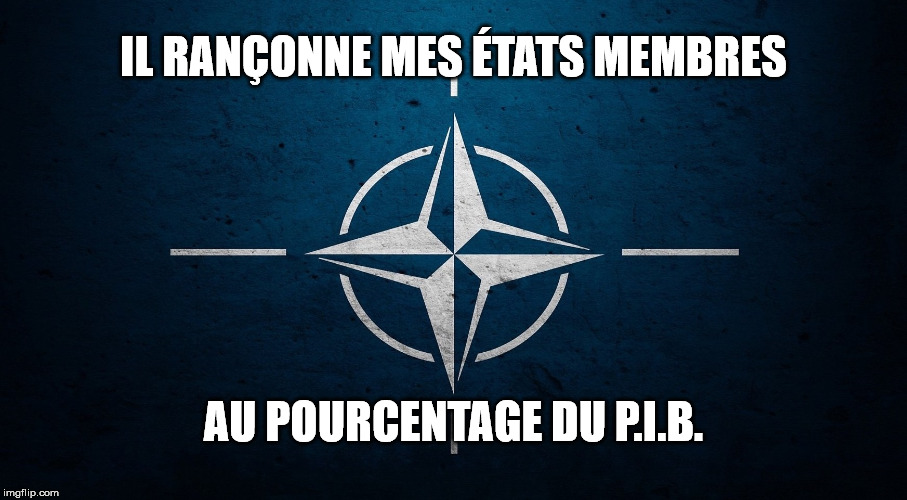


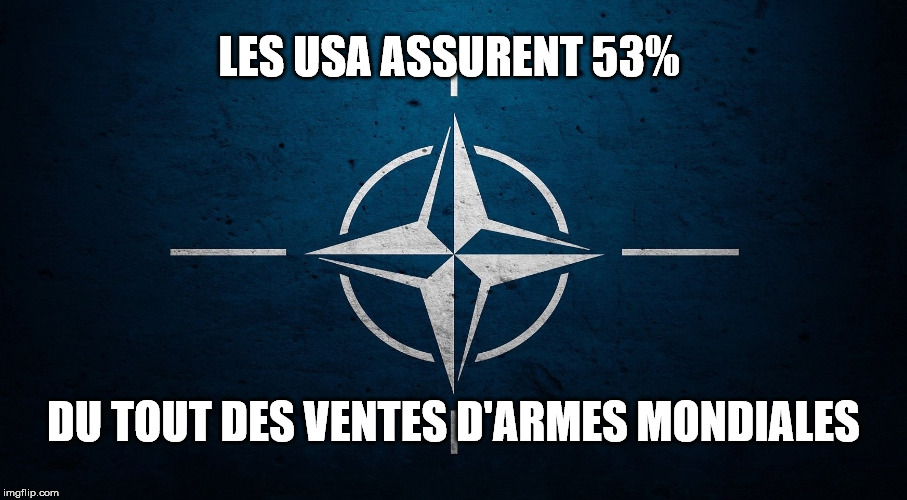


Posted in Civilisation du Nouveau Monde, Mèmes du mois, Monde, Vie politique ordinaire | Tagué: armes, bellicisme, bellicisme d’affaire, capitalisme, caricature, commerce des armes, Europe, guéguerres, guerre, guerres de théâtres, junte, mème, militarisme, OTAN, pacifisme, rançonnage, satire socio-politique, terreur latente par la guerre, USA | 1 Comment »
Posted by Ysengrimus sur 15 mars 2024

Technologie déterminante de la Génération Jones, le téléviseur (1955-1965)
.
La présentation journalistique contemporaine du dispositif des cohortes générationnelles occidentales a habituellement tendance à se configurer de la façon suivante :
Baby boomers : personnes nées entre 1945 et 1965 (cohorte de 20 années)
Génération X : personnes nées entre 1966 et 1980 (cohorte de 14 années)
Milléniaux : personnes nées entre 1981 et 1996 (cohorte de 15 années)
Génération Z : personnes nées entre 1997 et 2012 (cohorte de 15 années)
Génération Alpha : personnes nées depuis 2013
Or, quand on observe attentivement cette configuration et son fonctionnement, on s’aperçoit que les Baby boomers se prévalent, dans la fantasmatique journalistique contemporaine, d’une période de temps d’étalement excessive, vingt années, par rapport à quatorze ou quinze années pour les cohortes ultérieures. Or, les boomers, issus des fortes pulsions natalistes de l’immédiat après-guerre, sont déjà une cohorte volumineuse en soi. Si, par-dessus le tas, on leur ajoute cinq ou six années de durée en plus, ça ne va pas arranger leurs problèmes de poids générationnel. Mais surtout, par-dessus tout, on se rend compte aussi qu’en étalant ainsi sur deux décennies le phénomène du boom des bébés, on l’édulcore passablement et on compromet radicalement sa pertinence sociologique. En un mot, on se comporte comme si vingt ans après la fin de la seconde guerre mondiale, il y avait encore des enfants qui étaient nés suite aux pulsions natalistes de l’immédiat après-guerre. Quand même… C’est là étirer la sauce une petit peu trop, pour le coup. En réalité, on a là une façon de présenter les choses qui est toc, journalistique et superficielle et qui n’est pas conforme aux réalités des cohortes générationnelles telles qu’elles fonctionnent effectivement. Et lorsqu’on se rend compte de ce fait, on s’aperçoit qu’il faut en fait casser la lourde génération du boom des bébés en deux cohortes bien distinctes, de la façon suivante.
Baby boomers : personnes nées entre 1945 et 1955 (cohorte de 10 années)
Génération Jones : personnes nées entre 1955 et 1965 (cohorte de 10 années)
Je suis donc personnellement… puisque je suis né en 1958… de la Génération Jones. Mes sœurs et mon frère (1957, 1961, 1965) sont de la même cohorte. Il est très important d’établir cette distinction, car il n’est tout simplement pas possible de prétendre que je suis de la même génération que Daniel Cohn-Bendit (né en 1945), Donald Trump (né en 1946), Plume Latraverse (né en 1946) ou même Rémy Girard (né en 1950). L’étalement générationnel est trop grand. Ça ne fonctionne tout simplement pas. Les vrais représentants du boom des bébés sont ceux et celles qui, étant nés entre 1945 et 1955, ont connu, concrètement et empiriquement, la résistance à la guerre du Vietnam aux États-Unis, Mai 68 en France, et/ou le Vive le Québec libre du Général de Gaulle au Québec (1967). Or, en 1967, j’avais neuf ans, j’étais dans mon bac à sable, je jouais avec mes petites autos dans le sable et je ne participais aucunement au grand mouvement sociétal qui a été celui des années 1960. La Génération Jones est plutôt une cohorte de garçons et de filles qui étaient enfants et adolescents pendant le Watergate (1972-1974), pendant le premier choc pétrolier (1973) et pendant la fin des Trente Glorieuses (1975). C’est aussi la première génération qui a comme cruciale caractéristique technologique et ethnoculturelle d’avoir vécu toute sa vie dans une maisonnée où il y a toujours eu un téléviseur (unique ou multiple, mais initialement sans télécommande ni magnétoscope… le téléviseur tyrannique, donc). Ceci, alors que les représentants du boom des bébés ont vu le téléviseur entrer dans leur maison, ce qui n’est pas mon cas. J’ai toujours évolué dans une maisonnée où il y avait un téléviseur. Comme les Milléniaux (mes fils, 1990, 1993) ont toujours évolué dans une maisonnée où il y avait un ordinateur. Et comme les Z ont toujours évolué dans une culture familiale où il y avait un ou des téléphones portables. La Génération Jones est donc celle qui se retrouva dans le creux de la vague entre la génération des Baby boomers et la Génération X. La Génération Jones est une cohorte qui a connu, en son temps, la stagflation, les difficultés économiques, graves et subites, des chocs pétroliers (1973, 1979) et un très fort chômage des jeunes, résultant de l’encombrement démographique du à la masse des boomers. Nos profs de cégep et d’université, de vrais Baby boomers (de 1945-1955), eux, nous regardaient de haut. Et, avec une condescendance bien ostensible, ils nous disaient (vers 1977, ma première année d’université) qu’on avait pas connu les années 1960 et que l’effilochement du plein emploi faisait désormais de nous une génération de sacrifiés. En gros, on avait manqué le bateau annéessoixantard et on se le faisait dire. C’était pas très guilleret. Pour tout dire, quand c’était cool et pop d’être un digne représentant du boom des bébés, nous, les Jones, on n’en était pas, parce que trop jeunes. Maintenant que les boomers sont des ringards et des parasites sociaux, là, nous, les vagues inconnus de l’aval boomer, subitement, on en serait, sous prétexte que, dans le journal, ils viennent, sans justification sociologique particulière, d’étirer de dix ans le boom des bébés. Holà les petits folliculaires-bambins qui n’y connaissent rien, qui n’ont rien vécu de tout ça, et qui se posent en donneurs de leçons, revoyez votre copie. J’ai vraiment beaucoup de difficulté, aujourd’hui, maintenant que j’ai la barbe blanche, à me faire dire OK Boomer… tu as vécu la période de prospérité… etc… etc… alors que, dans le temps, je me faisais dire ti-pit, tu te souviens plus d’où t’étais quand Kennedy est mort (1963… effectivement, j’avais cinq ans) et t’es trop jeune pour chanter California dreamin’, va pointer au chômage… OK Boomer, ça s’applique aux gens qui sont nés entre 1945 et 1955, pas à ceux qui sont nés entre 1955 et 1965. De par un effet de mauvais recul, sans validité historique effective, la notion de Baby boomer gonfle démesurément avec la distance, comme une baloune sur le point de péter.
Notre culture-incurie journalistique contemporaine amplifie donc excessivement la cohorte des Baby boomers vers son aval. Incidemment, on notera qu’on a souvent tendance aussi à balouner cette cohorte vers son amont. Il est effectivement important de faire observer qu’un certain nombre de personnalités, que l’on prend d’office pour des boomers, n’en sont tout simplement pas, parce que trop vieux. John Lennon (né en 1940), Ringo Starr (né en 1940), Paul McCartney, (né en 1942), George Harrison (né en 1943) ne sont pas des boomers. On ajoutera d’autres figures majeures de la contre-culture, toutes nées pendant la guerre, Bob Dylan, Joan Baez, Buffy Sainte-Marie, Denis Arcand (tous et toutes nés en 1941, soit l’année de l’Opération Barbarossa). Tous ces braves gens ne sont pas des Baby boomers. Ils sont en fait de la cohorte qu’on a appelé la Génération silencieuse, génération pas très silencieuse, au demeurant… ahem…. quand on prend la mesure de la stature contre-culturelle des personnalités en cause. Enfin, tout ça pour dire qu’on voit toujours un peu trop grand pour les boomers, en amont comme en aval.
Revenons-en à la Génération Jones. En fait, elle est entrée dans l’attention générale, aux États-Unis, au moment de l’élection de 2008. Lors de ce scrutin historique, on avait, en position centrale d’attention, Barack Obama (né en 1961) et Sarah Palin (née en 1964). C’est alors qu’on s’est mis à se dire… mais ces gens-là ne sont pas vraiment des Baby boomers, car ils sont trop jeunes. Ils ont des caractéristiques qui ne sont pas celles des X non plus, car ils sont trop vieux. Et c’est là qu’est ressortie cette idée de la Génération Jones. Elle avait été formulée antérieurement, par un commentateur télévisé du nom de Jonathan Pontell. Nous sommes de plain-pied ici dans de la sociologie à l’américaine. Toutes ces désignations générationnelles sont mollement qualitatives, et en grande partie disposées ethno-culturellement, un peu sur le tas. Il ne faudrait pas y voir nécessairement une rigueur méthodologique excessive. Par contre, quand on regarde, par exemple, les cohortes précédentes, Génération silencieuse, Génération grandiose, on s’aperçoit qu’il se manifeste quand même des segments de réalité socio-historique exprimés dans ces grandes phases, notamment au plan de la résonnance ethnoculturelle et sociologique des technologies de masse. Disons encore un petit mot sur ceci.
Génération grandiose : personnes nées entre 1901 et 1927 (cohorte de 26 années)
Génération silencieuse : personnes nées entre 1928 et 1945 (cohorte de 17 années)
La Génération grandiose, qui est la cohorte de mon père (né en 1923) et de ma mère (née en 1924), c’est la génération de la radio. Et, de la même façon, la Génération X (1966-1980) est la cohorte du baladeur, du fameux Walkman. Le baladeur, à l’époque, était un petit objet technologique qui a eu un grand retentissement sociologique et ce, même si aujourd’hui on ne discerne plus trop quelle peut être l’importance de ce phénomène. Pour la première fois, il était possible de se promener dans la ville, en se coupant des stimulations extérieures et en écoutant la musique qu’on avait configurée dans notre monde intérieur. Cela a eu beaucoup d’impact et suscita toutes sortes de questionnements, en son temps, notamment autour de la riche problématique de l’interaction des ados avec leurs parents (dont ils se coupaient, plus souvent qu’à leur tour, de par les vertus isolantes et frondeuses des écouteurs du baladeur). Il faut bien remettre ces faits de sociologie vernaculaire des technologies de masse dans leurs contextes effectifs. Retour aux temps de mes chers parents. L’apparition de la radio fut un phénomène extraordinaire. Ma mère, jeune fille, a écouté de la fiction à la radio, des radioromans, de la même façon que j’allais, une génération plus tard, écouter de la fiction à la télévision, des téléromans. On peut aussi mentionner les fameuses Causeries au coin du feu (fireside chats) de Franklin Delano Roosevelt (entre 1933 et 1944) qui eurent énormément d’impact sue la Génération grandiose. Sur les Milleniaux (1981-1996), on signalera la mise en place de la culture hautement perfectionnée et durable du Jeu Vidéo, dont mes fils sont des experts consommés et dont je ne connais pas le premier mot. Ces phénomènes générationnels d’appropriation collective des technologies de masse comptent, socio-historiquement. Le fait que leur formulation descriptive procède plus de la stabilisation intellectuelle collective du résultat d’une manifestation de culture vernaculaire plutôt que de l’organisation savante d’une sociologie, articulée et précise, ne doit en rien minimiser leur importance.
Je tiens donc à insister sur ce point. Je ne suis pas un membre de la génération du boom des bébés. Je suis un membre de la Génération Jones. Cela me place tout juste entre le boom des bébés et la Génération X. Et cela a une incidence très profonde sur la définition que je me donne de moi-même. Les Peace and Love, les Hippies, les Yippies, les militants contre la guerre du Vietnam et les soixante-huitards m’ont précédé. Les enfants du baladeur, du boombox, du Punk, du New Wave et du No future m’ont succédé. J’apparais entre les deux, C’est comme ça que je me définis. S’il vous plaît, ne m’appelez pas un Boomer. Appelez-moi un Jones. C’est à la fois plus insultant, plus insignifiant, plus obscur… et plus précis.
.
.
.
Paru aussi dans Les 7 du Québec
.
.
.
Posted in Civilisation du Nouveau Monde, Culture vernaculaire, France, Monde, Philosophie, Québec | Tagué: baby-boomers, baladeur, Boom des Bébés, cohortes générationnelles, Génération Alpha, Génération grandiose, Génération Jones, Génération silencieuse, Génération X, Génération Z, Jeu Vidéo, Jonathan Pontell, Milléniaux, ordinateur, radio, radioroman, téléphone portable, téléroman, téléviseur, Walkman | 19 Comments »
Posted by Ysengrimus sur 1 mars 2024

La victoire de la rationalité est une victoire au long cours. C’est ça le problème […]. Je ne sais pas s’il y a une Raison dans l’Histoire objective, dans l’Histoire telle qu’elle se déroule. Mais je pense que lorsque les graines de la rationalité sont semées, sur une question déterminée, ceci fait son chemin… ceci fait son chemin. Nous avons de nombreux exemples. Et c’est de cette confiance-là dont je parle. Si vous avez le sentiment que, sur une question, vous avez une réponse ou une vision rationnelle, eh bien tenez votre point de vue. Essayez de le partager, tant que vous pouvez. Luttez pour lui. Et, en définitive, il arrivera quelque chose. Rien, de ce point de vue-là, n’est inutile. Tout ce qui peut être fait, en fonction des objectifs raisonnables, sur une question déterminée, doit être tenté. Et si on ne le fait pas, si on n’a pas cette confiance-là, on ne fait que céder le terrain aux pulsions irrationnelles qui, d’une certaine manière, sont encore dominantes… avec la pulsion principale qui est dominante, c’est, quand-même, le règne de l’intérêt privé, dans son sens, le plus… le plus… à vrai dire, le plus aveugle… le plus aveugle.
Alain Badiou, entretien avec Jean Comil, 2012
.
C’est avec une bonne dose de finesse sapientale qu’Alain Badiou fait ici la promotion du service, intellectuel et pratique, à la rationalité. Il commence par reprendre la notion hégélienne de Raison Objective, de Raison dans l’Histoire, en la problématisant discrètement. De fait, il s’avance en émettant un doute prudent à son égard, en disant que personnellement, subjectivement, il ne sait pas si on peut conclure à une vaste Rationalité qui imprégnerait objectivement l’Histoire. Alain Badiou, qui est un philosophe matérialiste, n’est pas tout de suite prêt à brandir les grandes idées catégoriales de l’Idéalisme objectif et à les installer, comme ça, à demeure, à l’intérieur de la réalité, comme si elles s’y incarnaient. Produit pratique, construit, ordinaire et intellectif, de l’action collective humaine, la rationalité n’est pas cette sorte d’absolu abstrait implacable, comme l’avait établi le système hégélien. C’est plutôt un enjeu récurrent, lancinant, auquel il faut continuer de réfléchir… et qu’il faut garder ouvert.
La question du service à la rationalité, ici chez Alain Badiou, apparaît comme directement associée à l’action, à l’intervention intellectuelle ou sociale. Et elle se pose d’une façon profondément dialectique… même au sens antique de ce terme. Observons d’abord qu’Alain Badiou n’identifie pas mécaniquement la rationalité à la vérité. Il ne s’agit pas de décréter, par avance, qu’il y a une façon claire et carrée, simplette et nette d’expliquer et de problématiser le tout des choses et que c’est celle-là qu’il faut imposer, et aucune autre. Non, ce n’est pas comme ça que ça fonctionne. La rationalité est une attitude revendiquée. Son établissement et sa stabilisation s’acquièrent interactivement, se gagnent socialement. La victoire de la rationalité est une victoire au long cours. C’est dire que c’est un voyage, un périple historique, une tribulation ancienne, où on va rencontrer des vents contraires et parcourir des océans complexes. À un certain moment, autour d’une question, dans le cadre d’une problématisation, une instance croit détenir les leviers de l’intervention rationnelle. Mais cette conviction n’est en rien assurée. Elle va devoir jouer de tension, s’avancer sur la scène du débat. Croire tenir la clef n’est que le premier pas de la conquête collective du traitement rationnel d’un problème. La recommandation de prendre parti et d’agir en conséquence s’impose alors, à la fois hardie et prudente. Si vous croyez avoir une compréhension rationnelle d’une situation. Allez-y, agissez, faites-en la promotion et il sortira quelque chose. Cela vaut de toute manière, sans rigidité ni dogmatisme, vu que, entre autres, si votre position est en fait irrationnelle, invalidable, non étayée, basée sur des assomptions indues ou des affects errants, les autres interventions du débat collectif vont apparaître et s’imposer, pour la pondérer, la ratiociner, ou la revoir et la refaire. Et c’est de ce débat que jaillira la rationalité, comme résultat consenti, acquis, non-immédiat et, surtout, collectif.
J’ai défini ailleurs en quoi consiste cette cruciale attitude de la pensée et de l’action qu’est la rationalité ordinaire. Il s’agit de cette capacité, naturelle mais acquise, de corréler adéquatement l’empirique au non-empirique, en réorganisant, dans notre esprit et dans notre pratique, un reflet, partiellement constatif et partiellement spéculé, du fonctionnement du monde. Sur ce point, daignez observer l’image du casse-tête, que j’ai placé en ouverture d’article. Le casse-tête, entre autres celui de type puzzle, ce passe-temps ancien, ce joujou séculaire, ce gnoséos simplifié, est une sorte d’exercice pratique ès rationalité. Très souvent, un casse-tête se solutionne de façon collective. Il représente la confrontation permanente entre une image empirique, un paysage, un objet, la photo qui fournit au casse-tête sa représentation visuelle, et une structure secrète, profonde, diaphane, organisée, qui doit se dégager et que l’on doit reproduire, en raccordant les pièces entre elles. La réflexion que l’on se fait, à propos de l’objet sur lequel on travaille, tâtonne en méthode, pour se stabiliser de façon adéquate. Et les morceaux du casse-tête, dans leur dimension secrète et profonde, contredisent l’image de surface, qui a, elle aussi, sa complexité propre. La rationalité, c’est justement ce qui nous fait arriver à résoudre un casse-tête et ce, malgré les détours auxquels semblent nous inviter les différentes facettes de son apparence superficielle. Noter —crucialement dans ce petit modèle— que, comme sur l’illustration, si un morceau manque, la rencontre mentale de l’empirique et du logique permettra habituellement de se le représenter visuellement, sans le voir. L’acte irrationnel par excellence ici est représenté par un enfant qui taillade certaines des pièces du casse-tête avec des ciseaux, pour les encastrer un peu partout, où bon lui semble, sur la surface dudit casse-tête, en croyant maladroitement imposer sa volonté à un monde qu’il faut pourtant comprendre avant tout… et modifier ensuite. Cet enfant cisailleur n’est vraiment pas un être anodin. Il est en chacun de nous, gorgé d’affect, d’émotivité, de langueur, de colère contenue, d’ardeur prélogique.
Ordinaire et pratique, ou contemplativement cogitatif, le voyage collectif de la rationalité va rencontrer un grand nombre d’écueils. Dans l’héritage issu de l’histoire de la philosophie, la majorité de ces écueils sont mis en saillie aujourd’hui par les héritiers intellectuels de l’irrationalisme. On se gargarise toujours amplement, dans l’amphi ou au troquet, pour faire la promotion des idées irrationnelles. On invoque Nietzsche, Kierkegaard, Heidegger, Henri Bergson, Novalis. Plotin & Cossin. En veux-tu, tant que t’en veux, il y en a. Or, en réalité, on fait face ici à un problème beaucoup plus complexe que celui de notre simple installation au sein d’un camp philosophique. Le programme rationnel doit se déployer, non pas selon une dynamique de scolastique philosophique, mais dans un rapport moteur à la pensée concrète et de par une activité soutenue, en abstraction intermédiaire. Alain Badiou nous fournit ici un exemple de manifestation de l’irrationalité, dans la vie ordinaire contemporaine. C’est le cas terrible du caractère privé de la grande propriété. Ce dernier est pleinement irrationnel en ce sens qu’il est diamétralement contraire au fonctionnement effectif de la vie civique et de l’existence sociale. Si le capitalisme est arrivé à perdurer, à trainer en longueur, c’est de par les luttes réformistes des travailleurs et des masses collectives. Sur une longue phase historique, les masses se sont approprié graduellement, par la force, une partie de la propriété. Et c’est cette motricité contradictoire qui a permis de maintenir le système en activité, en dépit des pulsions irrationnelles qui le définissent et le poussent vers sa débalance tendancielle. Si vous n’instaurez pas, volontairement ou non, ce genre de dynamique contradictoire travaillant l’intérieur du capitalisme, vous finissez coincé avec une situation comme celle rencontrée en 1929. Le grand capitalisme, aveugle, gagne. Il fait les poches à tout le monde, neutralise ses ennemis, paupérise les masses, tasse tous les biens dans le même racoin de classe, grimpe dessus et s’y enlise. Car d’avoir ainsi gagné, il perd. Il tue la circulation des capitaux pratiques qui le faisait vivre. Les grands avoirs colossaux qui sont détenus par des instances privées nuisent copieusement à la rationalité tendancielle des ressorts économiques. Ils devront, à un moment ou à un autre, selon un modus operandi ou un autre, être recollectivisés. C’est la seule façon de les organiser rationnellement. Un jour viendra.
La rationalité de pensée et d’action est une dynamique fluide. C’est un dispositif fondamentalement interactif. C’est un vaste résultat de masses, pratique, mobile, délié, toujours renouvelé. Ce n’est pas quelque chose d’inerte. Ce n’est pas une configuration mécanique et ce n’est certainement pas un gestus exempt d’émotions, joyeuses ou teigneuses. La rationalité est une chose qu’on acquiert. C’est une priorité de vision du monde que l’on sert et qui engage une importante dimension de prises de parti, donc un corps de croyances. Ces croyances sont autant d’hypothèses, à vérifier ou falsifier. Elles vont devoir se trouver pondérées et rajustées, dans l’interaction sociale. Plus tôt dans cet entretien, Alain Badiou a fait référence, pour exemplifier son propos, aux trois guerres qui ont été nécessaires pour finalement rendre les relations entre l’Allemagne et la France plus sereines. Trois guerres, dont deux mondiales, des millions de morts, qui étaient tous au service d’une irrationalité d’approche, c’est cher payer pour faire triompher le sain équilibre des choses, grandes et petites, en Europe, si tant est…. Une pagaille hirsute, pour arriver à un résultat finalement tendanciellement rationnel. On s’aperçoit, en citant ce cuisant exemple, comme en passant, que le coût de la rationalité peut être fort grand… et que le service à la rationalité est un devoir qui n’a rien de facile, de simple, ou d’évident. C’est bien pour ça qu’Alain Badiou mobilise ici la notion de confiance. Il faut faire confiance à la rationalité. Il faut continuer de la servir et si on ne le fait pas, eh bien on capitule et, en capitulant, on renonce, sur le long terme, à une configuration adéquate de l’existence sociale. Et là, c’est la porte ouverte à toutes les possibilités de dérives et à tous les excès. Ce qui fait la richesse de cette remarque ici, c’est que la rationalité n’est pas plate, linéaire, lisse ou inerte. Elle n’est aucunement exempte d’un rapport de crise, d’un dynamisme de débat et, fondamentalement, d’une motricité d’interaction sociale. La rationalité est fondamentalement dialectique. Elle émerge, elle se dégage. Elle est une immanence sociale et, en même temps, obligatoirement, elle transcende l’individuel. Il n’y a pas ma rationalité, la sienne ou la vôtre. Il y a une rationalité, à la fois fluente et systémique, comme résultat collectif. Et elle finit par prendre corps, pour un temps, quand le débat, et surtout l’action corrélée au débat, s’établit, se configure, se met en place, se stabilise, et entre dans l’Histoire.
Osons faire confiance à la thèse rationnelle. Le programme qu’elle avance est avec nous depuis au moins le Néolithique (et peut-être même avant). Sur le long terme, qui est celui du torrent immense du développement historique, nous ne nous tromperons pas, en luttant pour elle.
.
.
.
Paru aussi dans Les 7 du Québec
.
.
.
Posted in Citation commentée, Culture vernaculaire, France, Lutte des classes, Monde, Philosophie, Vie politique ordinaire | Tagué: Alain Badiou, antiphilosophie, Hegel, irrationalisme, lutte des classes, Philosophie, propriété privée, rationalité, service à la rationalité | 16 Comments »
Posted by Ysengrimus sur 15 février 2024










Posted in Civilisation du Nouveau Monde, Mèmes du mois, Monde, Vie politique ordinaire | Tagué: américanité occidentale, autoritarisme, caricature, Donald Trump, idéologie américaine, idéologie russe, impérialisme américain, impérialisme russe, influence russe en occident, mème, nouvelle guerre froide, politique, populisme, Russie, satire socio-politique, simplisme politique, USA, Vladimir Poutine | 18 Comments »
Posted by Ysengrimus sur 1 février 2024

On prend pied dans Brocéliande, un monde forestier où il y a des elfes, des centaures et des humains qui se regardent tous plus ou moins un petit peu de travers. Ce monde superficiellement paradisiaque est en fait en crise. Il est imperceptiblement envahi par des Créatures métalliques issues d’un sort ancien et non-maléfique instauré, il fut un temps, avec l’accord des rois elfe, centaure et humain pour faciliter les secteurs minier et métallurgique de la vie économique des habitants de Brocéliande. L’idée d’autrefois était de vitaliser, sans jeu de mot, la masse métallisée des terres collectives. Un ancien mage a donc instillé la vie dans les particules métalliques devant faire l’objet d’une prospection minière. Les dites particules, ferreuses et non-ferreuses, perlent alors à la surface des sols exploitables et deviennent très aisées à recueillir. Mais il faut strictement contenir ce processus vitalisant car la limaille tend, comme fatalement, à s’amalgamer hors-normes et à former des Créatures potentiellement nuisibles, qu’il faut capturer, avant qu’elles n’échappent à tout contrôle. On a ici une sorte de coup de l’Apprenti Sorcier, ni plus ni moins. Sauf que le sorcier bien tempéré et bien intentionné ayant lancé le processus n’est pas un apprenti. Il est tout le contraire, en fait. C’est un cacique et il a fini par casser sa pipe de cacique en laissant le sort du vitalisme minier du tout de la forêt de Brocéliande un peu en jachère. Et la merdouillardise métallique s’est un peu éparpillée et insidieusement installée, au grand dam des humains, des elfes et des centaures. Pour rétablir le contrôle sur les Créatures métalliques dont le vieux mage disparu a engendré l’émergence, il faut, au jour d’aujourd’hui, retrouver un des descendants du susdit sorcier. C’est que les aptitudes magiques ne s’enseignent pas strictement de tête, elles se transmettent à la descendance par le sang. Pour retrouver des descendants du vieux mage, avant que les Créatures ne virent involontairement ce petit monde forestier en foutoir sanglant, on investit deux vigoureux et industrieux champions. Le jeune humain Eliott et la jeune gorgone Élise. C’est alors que…
C’est alors que le second niveau de cette captivante fiction se met en place. Tout ce que je vous rapporte à l’alinéas précédent est rien d’autre que la trame de départ du scénario du jeu vidéo Créatures, en cours de configuration au sein de la florissante et dynamique entreprise Oméga Plus, boîte parisienne tonique et à la page, peuplée de jeunes programmeurs et programmeuses prometteurs et d’un directeur artistique aussi matois que sourcilleux. Ce dernier a procédé aux enquêtes de marché préliminaires d’usage sur des échantillons de clientèles potentielles et il a eu le regret de constater que, dans le jeu vidéo Créatures, la jeune gorgone Élise n’est pas assez charismatique (c’est la formulation froidement descriptive employée en réunion de travail par le directeur artistique et le scénariste du jeu vidéo). La décision est donc prise de retirer du jeu la jeune gorgone Élise (trop rousse, trop vive, trop féroce, trop carrée, trop atypique) et de la remplacer par Jade, une jeune archère quasi-féérique aux jolies couleurs scintillantes, élevée par des elfes, et à laquelle les petites filles jouant le jeu s’identifieront mieux, croit-on. Le retrait abrupt d’Élise du peloton du jeu vidéo Créatures sème une certaine consternation dans le petit collégium de jeunes programmeurs et programmeuses travaillant d’arrache-pied sur la conception du jeu. C’est que, sans trop se l’avouer ou s’en aviser, ils se sont attachés à la gorgone Élise. Un des programmeurs, un certain Raphaël, l’avait même nommé en référence à la petite fille de Julie, son amoureuse. Et la vraie Élise mondaine, qui est une petite fille de six ans qui adore dessiner, s’informe à tous les soirs de la progression et du cheminement de son alter ego, l’Élise virtuelle. Il va falloir maintenant engendrer bien des petites tristesses à cause de l’ablation subite de ce personnage unique, ayant pris sa place dans les cœurs. Il faudra agir ainsi, en plus, pour des raisons assez peu artistiques ou mythologiques au demeurant (mise en marché, conformisme d’image, attrait envers une clientèle cible, bref bof…). Sans joie mais sans pitié non plus, on décide alors que la façon la plus efficace de retirer la gorgone Élise du jeu vidéo, sans être obligés de trop s’enchevêtrer dans les arcanes déjà assez complexes du scénario, c’est simplement, les doigts tapotant sur les claviers, de la faire subitement traîtreusement assassiner par son co-équipier Eliott. C’est alors que…
C’est alors que nous revoici dans la forêt immémoriale du jeu vidéo. Le jeune humain Eliott pète une coche et se retourne sans sommation contre sa co-équipière Élise. Celle–ci normalement devrait présenter le torse à la pique et se laisser trucider sans coup férir. Glitch, pépin, maldonne et bug… la voici qui frémit, feule, s’insurge, se retourne, s’esquive, et prend la poudre d’escampette. Elle se coule dans la forêt, puis dans un labyrinthe de grottes, puis encore dans la forêt. Elle cavale, se trouve de discrets alliés, et entre à la fois en évasion et en subversion. Les programmeurs Raphaël, Alexia et leurs co-équipiers et co-équipières en restent bouche bée devant leurs écrans bourdonnant. Le vieux thème SF de l’autonomisation de la machine anthropomorphe face à ses créateurs revient alors nous hanter, cette fois-ci dans la riche et subtile mouture jeu vidéo. Simplement, les créateurs, ici, ne vont pas nous asséner le sursaut paniqué et sommaire des concitoyens obtus du docteur Frankenstein. Non, non, non, il y a beaucoup d’eau qui a coulé dans le grand fleuve de l’archaïque forêt de Brocéliande, devenue virtuelle et redessinée par les graphistes d’Omega Plus, depuis les hantises fondatrices de Mary Shelley. Nous sommes au vingt-et-unième siècle quand même et, dans ce théâtre toujours un peu Grèce antique de dieux se torgnolant entre eux, en prenant le parti de regarder vivre un petit monde influençable, l’humain contemporain n’est plus dans la position des anciens héros du poète Homère mais bien dans celle de ses anciens dieux… Ceci pour dire que la jeune gorgone Élise qui ne veut pas mourir et qui fuit dans la forêt, selon je ne sais quel algorithme aléatoire indéchiffrable, va trouver permis les jeunes programmeurs et programmeuses du petit collégium créatif d’Oméga Plus, des COMPLICES qui, à grands coups de bidouilles de codes, vont encadrer la gorgone Élise tout au long de sa surprenante quête angoissée et libératrice. Ils agiront envers elle comme les ancien dieux homériques envers Hector et Achille mais, bon, ce seront de VRAIS apprentis sorciers, eux, par contre. En un mot, ils barboteront sciemment leur cyber-grand’œuvre, quitte à radicalement altérer les psychologies, les cosmologies et à extirper sans pitié tous ces braves gens, elfes et centaures d’une certaine manière biscornue et naïve de paradis terrestre…
Et c’est là que les vraies péripéties merveilleuses, virulentes, imprévisibles et fascinantes, tant dans l’univers virtuel que dans le monde réel, vont vraiment démarrer. Je ne vous en ai strictement RIEN dit.
Laure Bénédicte nous livre ici un roman mi-fantasy mi-réaliste parfaitement savoureux. L’histoire, dans toute sa complexité à étages, est magistralement dominée. Le récit est enlevant. Les personnages sont irrésistibles. Et, par-dessus tout, bondance, c’est une femme qui tient la plume. Élise, Eliott et Jade (au plan virtuel) Julie, Raphaël et Alexia (au plan réel), et tous les autres, nous le feront sentir à chaque instant, au fil de ce roman picaresque, sentimental, prométhéen et passionnant.
.
.
.
.
.
.
Posted in Fiction, Monde, Sexage | Tagué: ÉLP éditeur, Contrôle: le monde d’Élise, Créatures I, cyberculture, Fantasy, femme, fiction, francophonie, Laure Bénédicte, roman, technologie | 13 Comments »
Posted by Ysengrimus sur 21 janvier 2024










Posted in Civilisation du Nouveau Monde, Culture vernaculaire, Mèmes du mois, Monde, Philosophie, Vie politique ordinaire | Tagué: aimer le troll, caricature, combattre le troll, culture troll, fin des trolls, mème, ne pas aimer le troll, ne pas alimenter le troll, rejet du troll, retour du troll, satire socio-politique, troll | 13 Comments »
Posted by Ysengrimus sur 25 décembre 2023



Posted in Culture vernaculaire, Mèmes du mois, Monde, Vie politique ordinaire | Tagué: Alexandre Loukachenko, boule de Noël, caricature, commerce et guerre, Jésus, mème, Noël, petites bibles dans les hôtels, satire socio-politique, Vladimir Poutine | 17 Comments »
CAMILLE CLAUDEL, LA VALSE DES GESTES (Denis Morin)
Posted by Ysengrimus sur 7 avril 2024
L’écrivain Denis Morin est à installer le genre, original et exploratoire, de la poésie biographique. En découvrant le présent ouvrage, on prend d’abord la mesure de l’art poétique, en soi, de Denis Morin. Le texte est court, lapidaire quoique très senti. La sensibilité artistique s’ouvrant vers les arts plastiques s’y manifeste d’une façon particulièrement tangible. Et alors, dans les replis de cette versification sobre et dépouillée, soudain, Camille Claudel (1864-1943) parle. Son ton est parfois rageur, parfois plus professionnel, pas nécessairement dans le bon sens du terme. On est devant une sorte de prosopopée en soliloque. Cela se joue comme si on s’installait tout doucement dans la tête même de Camille Claudel, guidés par les discrètes hypothèses biographiques de Denis Morin. Certains faits solidement étayés historiquement (mais toujours mal discernés, au sein de la mytholâtrie dans laquelle on entretient assez ouvertement le grand public sur les artistes éminents) sont mentionnés, comme tout naturellement. On pense par exemple au fait que le sculpteur et statuaire Auguste Rodin faisait travailler une foule de subalternes dont l’action et le savoir-faire contribuaient anonymement à son art. Le statuaire à la longue barbe et au monocle était littéralement un patron qui tyrannisait des employés. Au nombre de ces employés, il y a eu Camille Claudel (qui fut aussi son modèle et son amante) et elle, devant la postérité et l’histoire, elle n’allait certainement pas se laisser faire.
Claudel ne doit rien à Rodin. Elle ne fut pas une disciple ou une épigone. Elle détenait sa propre force artistique intérieure. L’analyse du travail collectif des hommes et des femmes de l’atelier de Rodin, parfaitement étayé historiquement donc, se complète ensuite d’une hypothèse plus personnelle de Denis Morin sur les conceptions et les tourments intérieurs de la statuaire. Littéralement, le poète se fait biographe et, ici, il amène Camille Claudel, sur un ton semi-confidentiel, comme auto-réflexif, à nous narrer certains segments de sa vie. Le personnage-narratrice ne se décrit pas exhaustivement (comme si, par exemple, la prosopopée imitait une entrevue). C’est plutôt une sorte de réflexion intérieure, de bilan doux-amer, allusif, furtif. Le tout résulte sur une manière de synthèse personnelle qui se susurre du bout des lèvres. Le fait est que Camille Claudel a fait les petites mains pour Rodin (au sens littéral aussi, surtout peut-être, même). En effet, on lui doit notamment les extrémités des membres de la si célèbre statue de groupe Les bourgeois de Calais. Et on parle de cela, comme allusivement. On encore on relate une galerie de souvenirs. Des souvenirs virulents qui, inexorablement, virent à une très aigre énumération en cascade.
Et, oui, l’être de Camille Claudel partira effectivement à la dérive. La folie la guette. Sans s’appesantir, on passe en revue les différents avatars de la relation de Rodin avec Camille Claudel, C’est le rapport de force constant entre les deux statuaires de Giganti. C’est donc aussi tout le conflit artistique et les manœuvres avec Paul Claudel pour faire interner sa sœur, à raison ou à tort. Elle finira en asile et ne sculptera plus jamais. Mais elle continuera de se rebiffer, toujours obsédée de Rodin
Et puis enfin, au bout du bout du rapport de force, de la jalousie, de la gloriole et de la folie, on en arrive enfin à l’art. Camille Claudel transgresse ouvertement Rodin. Chez Rodin (avant qu’il ne se claudélise, notamment de par son Balzac), comme chez maint statuaires ronron pour grands monuments de ville, le matériau se plie veulement aux objectifs figuratifs du contrat. Chez Camille Claudel, au contraire, la représentation du thème est dévorée, boursouflée et corrodée dans la subversion par le matériau. Si Giganti souffre, la glaise le montre et se traîne. Si les amoureux jouissent, les marbres le crient, se dressent et s’emportent. On regarde un tout petit peu Camille Claudel travailler et cela est vraiment le plus beau et le plus sublime. C’est cela, avant tout, et par-dessus tout, la valse des gestes. Ainsi, par exemple, transférer une œuvre de glaise dans le marbre, c’est, avec le matériau en mouvement sous la main, une véritable étreinte.
L’amour des chairs et des personnes, la passion des glaises molles et des marbres durs se rejoignent et s’amplifient mutuellement. L’émotion de la statuaire ne se sépare tout simplement pas de sa vie, elle en émane plutôt, s’en extirpe, comme un mystérieux esprit d’alcool. Et Denis Morin nous le donne ici, en poète biographe qui joue, lui aussi de ce matériau complexe dur et labile. C’est toujours subtil mais c’est pas nécessairement empêtré dans le factuel conjoncturel que l’on retrouvera, bien en ordre, chez les biographes conventionnels. Au corpus des hypothèses de Denis Morin sur Camille Claudel s’ajoute tout doucement le corpus de ses émotions. Le recueil est composé de vingt poèmes (pp 5-34), ponctués de dix citations d’exergues. Il se complète d’une chronologie détaillée de la vie de Camille Claudel. (pp 35-68) et d’une liste de références (p. 2). De plus, un CD-ROM, enchâssé dans l’ouvrage de Denis Morin sur Auguste Rodin, a deux plages. La première est un récitatif de l’intégralité du recueil sur Rodin. La seconde plage de ce CD-ROM est le récitatif du recueil Camille Claudel, la valse des gestes, récitatif passionné, assuré principalement par Jacqueline Barral.
.
Extrait des fiches descriptives des cyber-libraires:
.
.
.
.
Posted in Citation commentée, France, Monde, Poésie | Tagué: art plastique, Auguste Rodin, biographie, Camille Claudel, Denis Morin, femme, France, histoire de l'art, homme, la vie à pleines mains, poésie biographique, Rose Beuret, sculpture, sculpture extérieure, statuaire | 3 Comments »