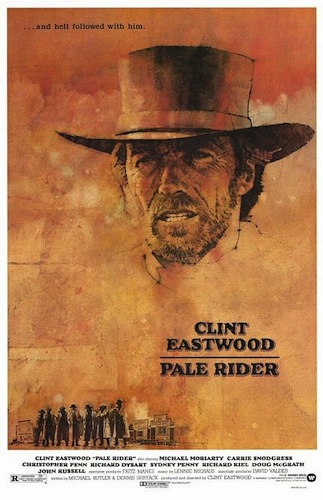Le film de Sergio Leone Le bon, la brute et le truand (Il buono, il brutto, il cattivo — The Good, the Bad and the Ugly) date de 1966. J’avais huit ans et j’en ai entendu l’extraordinaire musique (composée par Ennio Morricone) bien avant de prendre connaissance de l’opus. Dans ces années là, il fallait attendre que le film passe à la télé, en surveillant attentivement le guide télé pour le choper. Il faudrait évidemment, l’heureux jour venu, se le taper coupé de pubes (ces dernières empiétaient souvent sur le temps de film même. On se retrouvait donc avec une version petit écran brutalement éditée par les pubards). J’ai eu la chance de le revoir plusieurs fois depuis ma tendre enfance, dans la ci-devant extended edition qui dure trois heures. Ce truc est sans âge. Possiblement le meilleur western de tous les temps.
Nous sommes en 1862 et la Guerre de Sécession bat son plein. De fait, elle s’étend vers l’ouest. Les sudistes venus du Texas attaquent le territoire du Nouveau-Mexique, tenu par les nordistes, qui les refoulent, notamment en canonnant les bleds occupés pas l’armée sudiste chez laquelle on sent déjà les premiers signes du vacillement. Nous suivons trois individus peu fréquentables au sort initialement épars. Tuco (Eli Wallach) est un petit truand de sac et de corde. Il est recherché dans tous les bleds du coin pour une kyrielle de crimes épars. Toutes sortes d’olibrius veulent lui régler son sort. Sa tête est mise à prix. Éventuellement, il s’associe à Blondie (Clint Eastwood) en une astuce risquée mais payante. Le bon Blondie livre Tuco et touche la prime. Quand Tuco, le cul sur un cheval, est pendu haut et court sur la place du bled, Blondie, à bonne distance, coupe la corde d’un coup de Winchester. On se regroupe dans le désert et on renouvelle la combine, dans la commune suivante. Dans une de ces communes passe justement Angel Eyes (Lee Van Cleef) qui observe Blondie et Tuco d’un air amusé. Angel Eyes, dit aussi Sentenza, c’est une brute livide qui vient de descendre un type en se mettant au service d’un autre type qu’il descend aussi après coup pour se conformer aux doléances du premier type, déjà mort par ses soins. C’est qu’en entrechoquant ces deux cadavres, Angel Eyes finit par apprendre l’existence d’un soldat sudiste avec un bandeau sur l’œil (un certain Bill Carson) qui a sauté la somme de 200,000 dollars en pièces d’or, la paye des soldats sudistes, et l’a enterrée dans un endroit inconnu. Angel Eyes, après avoir ainsi soigneusement trucidé les détenteurs de ce secret, se met en quête.
L’association entre Blondie et Tuco se détériore. Blondie tire un malin plaisir à humilier Tuco, à le trahir, à l’abandonner. Tuco, qui est une bête acharnée et hargneuse devient vindicatif. Il traque Blondie, le retrace, le cerne. En point d’orgue de ce jeu du chat et de la souris, on retrouve Tuco en selle, gourde en main et petit parasol rose au dessus de la tête, en train de faire marcher un Blondie assoiffé et désarmé dans les dunes du désert. Au moment où Tuco va se décider à descendre Blondie, une carriole bourrée de sudistes agonisants se fait voir sur l’horizon. Au nombre de ces mourants, un étrange personnage avec un bandeau sur l’œil. Il parle à Tuco d’un pactole en pièces d’or enterré dans un cimetière. Il confie à Tuco le nom du cimetière. Négligeant Blondie, le petit truand court chercher sa gourde pour faire boire le sudiste au bandeau. Imbroglio. C’est à Blondie que ce dernier confie le nom inscrit sur la tombe où se trouve le grisbi et il meurt dare-dare. Impasse des savoirs. Tuco ne peut plus éliminer Blondie. Ils détiennent chacun une portion du secret à l’intégralité duquel l’autre aspire: Tuco le nom du cimetière, Blondie le nom écrit sur la tombe sous laquelle se trouve le trésor. Les voici derechef soudés, forcés de devenir ou redevenir les meilleurs amis du monde.
Et c’est ici que la Storia s’en mêle. Après avoir fait soigner un Blondie gravement déshydraté, dans un monastère du voisinage, Tuco assume l’identité du sudiste au bandeau et les voici, fringués en sudistes, qui se dirigent en douce, dans la carriole des agonisés vidée de son contenu, vers le cimetière non-nommé. Manque de bol, ils se font épinglés par les nordistes et incarcérer dans un camp de prisonniers sudistes dont le sous-chef est nul autre qu’Angel Eyes, devenu officier nordiste pour mieux retrouver son sudiste au bandeau. Il a corrompu une portion de la garnison du camp et s’est constitué une petite pègre qui fait des passages à tabacs méthodiques pour pister le susdit sudiste au bandeau. Comme Tuco se fait passer pour ce dernier, mort, notamment en portant son bandeau, il se prend une dégelée et finit par avouer le nom du cimetière à Angel Eyes et par lui couler que Blondie connaît le nom de la tombe sous laquelle est le pactole. On déporte ensuite Tuco, menotté à un gros sergent, que, dans sa rage constante et entière, Tuco finira par descendre et dont il parviendra à se libérer. Pour remettre tout de go le cap sur le cimetière non-nommé.
Angel Eyes considère qu’il est inutile de torturer Blondie, dur à cuir intemporel qui, contrairement à Tuco, petit épicurien rustaud et sensible, ne parlera, lui Blondie, jamais. Angels Eyes invite plutôt ledit Blondie à se joindre à la bande de six déserteurs nordistes qu’il s’est constitué pour monter chercher le trésor sudiste. Comme il va falloir se faufiler entre les deux armées de la grande Guerre Civile américaine, on passe par un bled qu’elles se disputent au canon. Blondie, ouvertement cerné par les sbires d’Angel Eyes, entend au loin les détonations de la pétoire inimitable du fringuant Tuco (qui est à se débarrasser d’un autre des multiples enquiquineurs voulant lui faire un sort). Blondie part retrouver Tuco dans les décombres de la ville bombardée et à deux, il se mettent à méthodiquement cartonner un à un les sbires d’Angel Eyes. Ce dernier se débine en douce et s’en va tranquillement les attendre au cimetière toujours non-nommé.
Et Tuco et Blondie de se rendre au même endroit par une autre route. Manque de bol, ils doivent franchir un pont stratégique que justement les deux armées se disputent en se refusant à le détruire. Tuco et Blondie détruiront aux explosifs ledit pont, histoire de tasser le front de dans leurs jambes et de pouvoir se rendre au cimetière non-nommé. Ils s’y retrouveront enfin et rejoindront Angel Eyes pour l’ultime confrontation à trois, devant fatalement déterminer qui mettra la patte sur les sacs de dollars-or.
On suit donc le cheminement de trois cyniques insensibles qui, au mépris de la Storia et des causes sociales ou nationales, vaquent à leur propre enrichissement compétitif personnel en s’engageant dans des alliances circonstancielles de larrons, sans plus. Comme, en plus, les trois persos sont incroyablement attachants, il est difficile de ne pas admettre que Sergio Leone fait ici l’apologie de leur quête égotiste. On avait prévenu Leone, incidemment, contre les films de Guerre de Sécession qui font, parait-il, fours sur fours. La victoire éclatante de Leone ici est que, non-américain, il ne s’est pas empêtré dans les langueurs barbantes de la mythologisation sécessionniste et/ou yankee (dont les ricains, eux, ne se sortent jamais vraiment). Sans prendre parti sur le grand schisme américain en bleu et en gris (vu que, comme nous tous, il s’en tape souverainement), Leone a su, comme l’aurait fait par exemple un petit immigrant italien, décrire froidement le grand cynisme américain fondamental, dans toute sa splendeur livide. Le succès fut tonitruant. Ce film est aujourd’hui un des fiers fleurons du corpus mythique de la cinématographie de masse du siècle dernier.
Et, pour en tartiner une couche supplémentaire, il est absolument indispensable de mentionner derechef l’incroyable puissance d’évocation de la bande sonore d’Ennio Morricone. J’ai trippé sur ce disque, dans mon enfance, longtemps avant que de voir le film. Sergio Leone avait dit une fois de Morricone: il n’est pas mon compositeur de bande sonore, il est mon scénariste… On peut ajouter qu’il fut aussi, en quelque sorte, son agent publicitaire, parce que c’est en écoutant cette musique magistrale que j’en suis venu à mourir d’envie de voir le film. Et de le voir et de le revoir sans fin, juste pour admirer Tuco courant follement entre les tombes concentriques du cimetière de Sad Hill, sur le thème extraordinaire et magnifiquement ouvré de L’Estasi Dell’Oro…
Le bon, la brute et le truand, 1966, Sergio Leone, film italien avec Clint Eastwood, Lee Van Cleef, Eli Wallach, Aldo Giuffrè, Luigi Pistilli, Rada Rassimov, 160 minutes.