
Ce n’est pas raisonnable, mais qu’y faire? Voyez Gauguin: à la fin, il débordait tellement qu’il ne se contentait plus de peindre et de sculpter, il écrivait en plus.
Allan Erwan Berger, Dictionnaire de mauvaise foi
.
.
.
Paul Laurendeau (Ysengrimus): Allan Erwan Berger votre recueil de textes traitant, sous forme de glossaire, de la filandreuse condition intellectuelle humaine et du lot bringuebalant de ses avatars passés et contemporains incorpore ouvertement et problématise la notion vernaculaire de mauvaise foi. Commençons si vous le voulez bien par elle. Quelle est-elle? D’où sort-elle? Et que nous dit-elle sur nous-même?
Allan Erwan Berger: Quand je suis de mauvaise foi, je refuse l’évidence. Donc je n’assume pas. Donc je fuis. En refusant le monde existant et en brandissant à sa place une histoire qui me sert de cadre, je renonce à toute prétention à l’autonomie et donc à la liberté. Je file à la niche, je m’y poste à l’entrée et je grogne. En outre, puisque je suis de mauvaise foi, et que je le sais, je cherche à la masquer en en répandant les effets. Car plus il y aura de victimes, moins ma mauvaise foi sera visible, moins elle paraîtra grave. Plus elle sera jugée bénigne, amusante même, pardonnable… et pourquoi pas: utilisable. Donc j’intoxique. Je travaille à étendre le mensonge et l’erreur. Par mon action, autrui devient esclave. Nul raisonnement ne saurait prévaloir sur de la mauvaise foi. Nulle bonne foi non plus. Il n’y a que la force qui peut la contraindre à se taire. Or, la force, ça se cultive. On la fait pousser. On l’entretient. La force des ennemis de la mauvaise foi s’obtient en manipulant non pas des haltères ou des armes mais de l’honnêteté, et en la mettant dans les mains d’autrui, avec son mode d’emploi. En somme, il s’agit ici d’une compétition entre deux prêches.
Paul Laurendeau (Ysengrimus): Et on le sent bien tout au long de l’exposé. Cela oblige à dire un mot aussi de la notion de Dictionnaire. Avec quarante-trois entrées, votre dico est, de fait, un petit glossaire. La désignation Dictionnaire est ici largement ironique mais pas que… Un choix de formulation s’y exprime, dans la façon même d’organiser le savoir. Historiquement, le dico c’est un type de discours, une classification s’efforçant de se placer un peu au-dessus de la mêlée. Mais certains penseurs grinçants autant que fort savants ont prouvé, au fil de notre tradition culturelle, que la fausse neutralité du dico pouvait être un moyen de s’avancer militant mais masqué. Pierre Bayle, Les Encyclopédiste, même Pierre Larousse, positiviste, laïc et scientiste, sont là pour en témoigner. Votre dico est-il la recherche d’un discours neutre, distancié (apanage disons naïf du dico dans la culture contemporaine) ou s’assume-t-il, pour reprendre votre mot, comme étant l’exposé semi-satirique d’un des prêches?
Allan Erwan Berger: Dico prêcheur, complètement, puisque c’est un dictionnaire de combat. Mais notez bien: il regorge de points de vue, de questions, d’incertitudes et de paradoxes, sans oublier les contradictions. Bref il grouille d’un tas d’horreurs qui font enrager n’importe quel individu attaqué par une croyance, et il file le vertige à tous les adeptes de la mauvaise foi. Ce recueil est en fait une pelote d’épingles. C’est une mise à jour du dictionnaire voltairien, ouvrage sanglant qui se prend intégralement au sérieux même lorsqu’il ricane. Ici, c’est pire: si je brandis une arme et qu’un Ysengrimus ou un Ducharme en voit le défaut (car j’ai convié mes compères à discuter mes discussions), elle s’émousse en direct sous le nez du lecteur ébahi qui n’aura plus alors qu’une solution pour s’en sortir: chercher où se nichent les bouts de raison raisonnable, identifier les points de vue, comprendre comment ils influent sur les discours, et faire sa pêche là-dedans comme il pourra. Ce faisant, il réfléchira, et sera moins que jamais en état de se faire piéger par de la mauvaise foi.
Paul Laurendeau (Ysengrimus): Un dico dialectique et dialogique en somme. Peu commun. On sent un jeu, dans tous les sens du terme. Or, justement, dans votre nomenclature, des notions incontournables comme Peuple, Civilisation, Laïcité, Souveraineté, Solidarité, Fraternité côtoient des petits trublions notionnels titillationnesques comme Cardinal, Cartable, Lecteur, Ripaille, Satire, Tiédeur. Un certain éclectisme post-voltairien est indubitablement voulu et, tout prosaïquement, cela instille l’envie de lire. Et faut-il voir dans de telles variations de la nomenclature un autre jeu ou une prise de partie ontologique plus fondamentale sur la rencontre classificatoire entre le concret et l’abstrait?
Allan Erwan Berger: Un jeu! C’est un jeu! Des tas de mots qui désignent des choses concrètes génèrent des gamberges qui folâtrent du côté de la pensée abstraite, se roulent dedans et y font des petits. Par exemple: Député. J’aurais dû traiter ce mot. Il manque. Dommage. Bref. Un député, ça vaut bien un cardinal, c’est souvent une montagne de mauvaise foi, ça manipule la tiédeur avec un doigté consommé, ça hait la satire, entretient des relations ambiguës avec la souveraineté, prétend parler au nom du peuple et a des idées toujours loufoques à propos de la laïcité – dans la France de 2015, des politiciens soutiennent un proviseur qui a considéré qu’une jupe trop longue était anti-laïque, et ils en rajoutent, étalant au passage une inculture qui devrait leur valoir des nuées de légumes périmés, mais comme ils disent tout ceci à la télévision (qui est un endroit où il faut être bête) il ne leur arrive rien de plus grave qu’une question, bête nécessairement, posée par… on va dire un journaliste, c’est-à-dire un commensal. Alors donc non, je ne sépare rien. Partant, ce qui se rencontre le fait parce que c’est naturel, les mots qui se côtoient dans cet ouvrage arrivent avec tous leurs bagages, et je ne leur abstraits rien qui permettrait de les classer. Il me semble bien que Bayle ne s’interdisait aucun zigzag.
Paul Laurendeau (Ysengrimus): Oh, que non. Un mot justement sur les mots et leurs bagages. Vous cultivez, dans certains de vos développements, ce qu’il convient d’appeler la glottognoséologie. C’est une idée de philosophie vernaculaire voulant que les mots, leur sens, leur présence ou leur absence dans le corpus lexical d’une langue donnée soient, d’une façon ou d’une autre, des indicateurs intellectuels sur les locuteurs de cette langue. Or, quand Salman Rusdie dans Imaginary Homelands (1981) s’insurge un peu du fait que la langue Hindoustani n’aie pas de mot lexical pour secularism, il nous dit ceci: It is perhaps significant that there is no commonly used Hindustani word for ‘secularism’, the importance of the secular ideal in India has simply been assumed, in a rather unexamined way. Et c’est là effectivement tout le paradoxe glottognoséologique. Le fait que nos langues aient une formulation vague ou inexistante pour certains concepts est-il un indice du fait que ces concepts, esquissés sommairement dans nos idiomes, nous échappent… OU ALORS du fait qu’ils sont vécus si intimement que tout va sans dire? Je vous pose la question. Et, plus globalement, que nous dites-vous de glottognoséologique suite à votre longue et sulfureuse baignade dans le fumeux lagon dictionnairique?
Allan Erwan Berger: Dans cette citation, Salman Rushdie suppose que l’importance de la laïcité en Inde serait tranquillement «présumée», et qu’il n’y aurait donc pas à se pencher dessus, en tout cas pas au point d’inventer un mot pour ça – ce qui permettrait, par exemple, d’en parler. J’ai le sentiment que monsieur Rushdie joue ici volontairement au gars de très mauvaise foi, peut-être pour nous faire détecter l’existence d’un bon gros blocage. Car après tout, quand un terme n’existe pas, c’est que le concept auquel il renvoie soit n’est pas perçu, soit n’est pas pensé. S’il n’est pas perçu, c’est parce qu’il ne s’est jamais présenté. Mais dès lors qu’il se présente, s’il n’est toujours pas pensé, c’est qu’il n’est pas pensable. Or, il me semble bien que les gens, depuis le temps que l’humanité existe, ont inventé toutes sortes de mots pour exprimer ce qui les touche au plus intime. Je n’imagine donc pas qu’un de ces mots-là puisse manquer pour une raison autre que théologique, psychologique ou idéologique. On occulte là un concept. Mais quand le concept existe, et qu’il a son mot? Comment faire pour réduire les gens au silence à son propos? La solution est toute orwellienne: il faut gommer le concept en volant son mot. Je donne quelques exemples. Personnellement, je serais plutôt du genre à courir derrière pour essayer de le récupérer – les lecteurs verront que mes galopades donnent naissance à de beaux commentaires dans le corps du texte. Mais tel camarade a une autre idée: replanter le concept dans un mot nouveau, et merde aux voleurs.
Paul Laurendeau (Ysengrimus): Comme Rushdie, vous mentionnez ici la dimension théologique des choses dans la mauvaise foi… et vous y restez passablement attentif dans votre ouvrage aussi. De fait, les sujets ayant trait à la religion, pour ne pas dire au christianisme (Dieu, Religion, Créationnisme, Miracle, Prochain, Révélation, Sacrifice), semblent occuper beaucoup d’espace dans votre ouvrage. De bonne foi ou de mauvaise, doit-on voir là la distinction d’un temps ou les hantises d’un homme?
Allan Erwan Berger: Les deux, mon capitaine. La religion s’agite, revient sur nos libertés, exhibe ses indécences. Le pire est qu’elle déteint sur la société, qui s’en trouve altérée. Par exemple, il est en France aujourd’hui presque impossible de se tenir seins nus à la plage. On vous regarde de travers, on vous fait des réflexions. Alors que, quand j’étais enfant, l’exposition des seins était une beauté reçue dans les mœurs de presque toutes les régions. Vraiment, il y a du Tartuffe qui revient en masse dans ce pays, et cela me hante. Raison pour laquelle mon dictionnaire est complètement, rageusement, obstinément de mauvaise foi: il brandit à chaque entrée, contre les bassesses immorales de la croyance, les vertus de l’ignorance et du savoir, les vertus de la recherche et de l’incertitude.
Paul Laurendeau (Ysengrimus): On va conclure un petit peu sur ça: quelque chose qui se présente à travers les saveurs de l’incertitude. Je voudrais en effet en revenir aux interventions-commentaires de vos deux complices, Ducharme et Laurendeau, auxquelles vous faisiez allusion tout à l’heure. Elles apparaissent, un peu aléatoirement, en conclusion de certains de vos articles (pas tous). J’aimerais que vous développiez un peu, en point d’orgue, sur ce qui motive en vous cet appel dialectique ou maïeutique aux interventions des pairs. L’idée, originale, généreuse et méritoire, vient entièrement de vous. Elle résulte de votre bon vouloir. Les comparses s’y prêtent de bonne grâce. Que font-ils tant dans votre jardin et qu’attendez-vous tant d’eux en vos plates-bandes ?
Allan Erwan Berger : L’idée a été lancée par Daniel Ducharme qui l’a exploitée en nous mettant à contribution pour son propre dictionnaire, Ces mots qu’on ne cherche pas. À chaque entrée, nous avons donné nos propres définitions à la suite des siennes. Pour ce dico-ci, la différence est que j’ai invité les compères à commenter uniquement là où ça leur chantait, et non pas systématiquement. Se dessinent ainsi des profils, des caractères, que soulignent les préférences dans les interventions. Soudain, l’information ne vient plus seulement de ce qui est dit, mais aussi de là où ça se dit. Je trouve ça plutôt pas mal. Et puis la forme ne demandait qu’à évoluer tranquillement vers les discussions de blog(ue)s; ça aussi c’est plutôt pas mal. Cela montre surtout qu’il n’est pas possible de penser seul, même après (en ce qui me concerne) cinquante ans de gamberges et de sérieuses lectures. Il faut, finalement, accepter de faire le contraire de ce que font les pauvres gens qui sont enfermés dans une croyance ou de la mauvaise foi: il faut papoter avec des quidams qui ne regardent pas forcément depuis là où vous regardez. Les fameux points de vues différents sur les choses. Le tout est de s’entendre sur le sens des mots, et de postuler, chez tous les intervenants, la présence, nécessaire, cruciale, d’une solide et bienveillante bonne foi nourrie, dans le cas présent, d’histoire et de philosophie.
Paul Laurendeau (Ysengrimus): Poil aux sourcils…
.
.
.
Allan Erwan Berger (2015), Dictionnaire de mauvaise foi, ÉLP Éditeur, Montréal, format ePub ou Mobi.
.
.
.
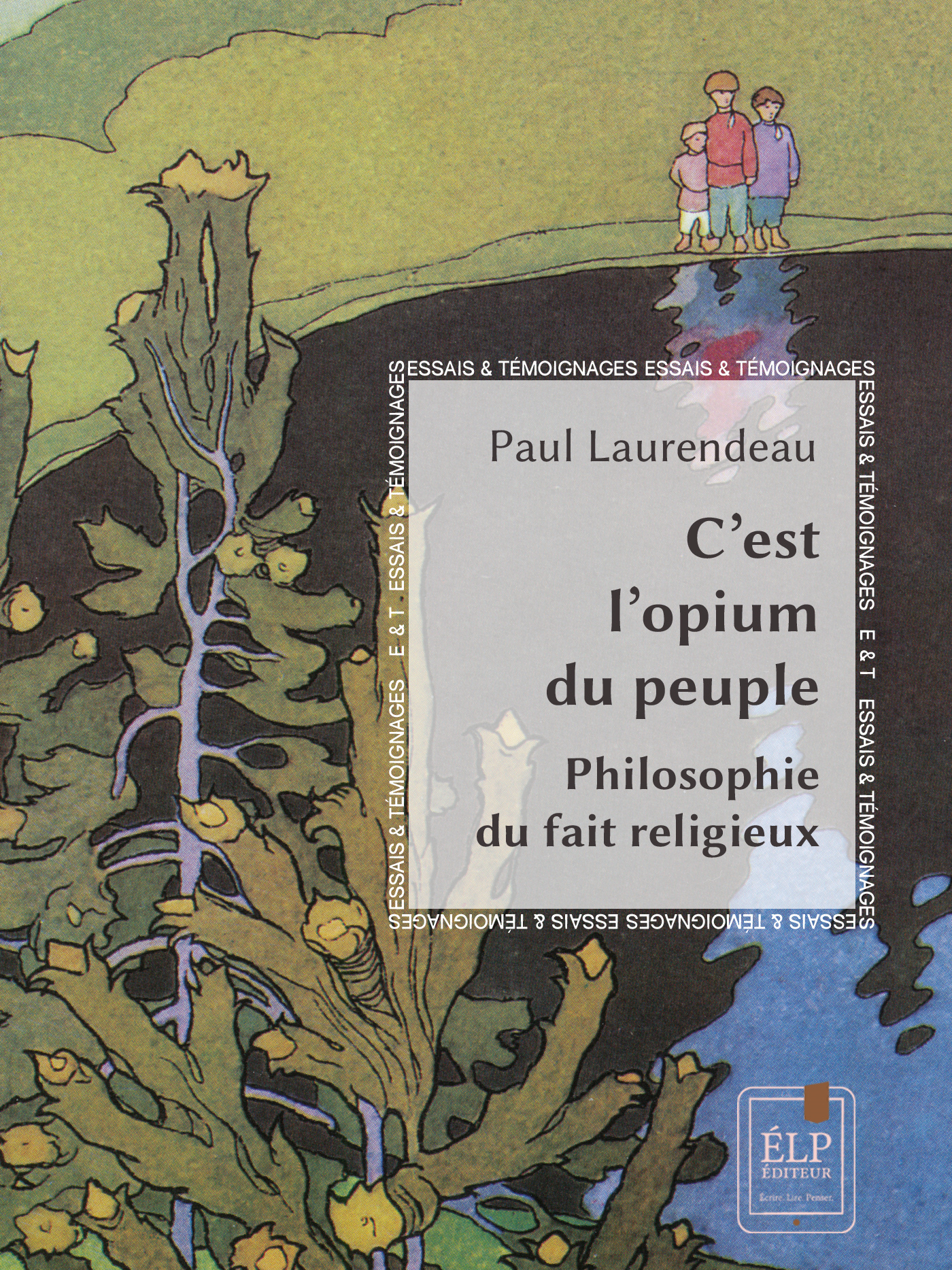

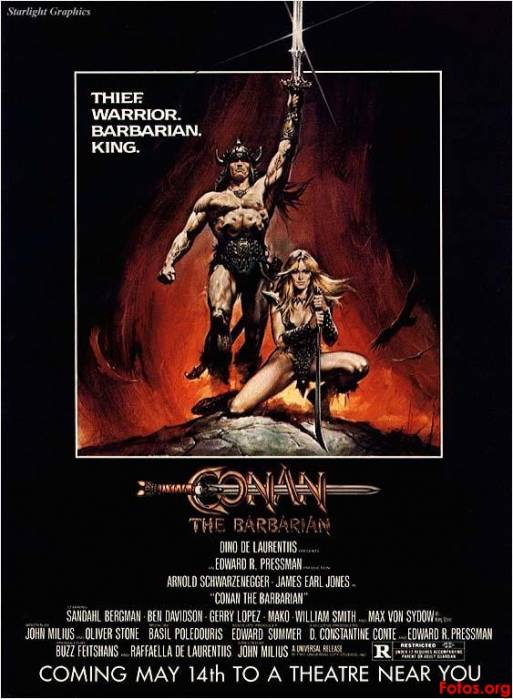










COMMENT JE SUIS DEVENU MUSULMAN (Théâtre du Rideau vert, Septembre 2019)
Posted by Ysengrimus sur 21 septembre 2019
.
On va d’abord poser nos protagonistes. Ysengrimus (votre humble serviteur, 61 ans), Reinardus-le-goupil (son fils), la Dame à la Guitare (épouse de Reinardus) et Clef de Sagesse (grande amie de l’épouse de Reinardus). Ces trois jeunes gens (26 ans en moyenne) ont eu la gentillesse de m’inviter à auditionner la pièce de théâtre Comment je suis devenu musulman de Simon Boudreault, au Théâtre du Rideau vert (Septembre 2019).
Comprenons bien maintenant l’armature philosophique et intellectuelle du solide petit quatuor critique qui s’est mis en branle ce soir là, au milieu des spectateurs du grand dispositif scénique historique de madame Filiatrault. Clef de Sagesse et la Dame à la Guitare sont toutes les deux des kabyles algériennes de seconde génération, étudiantes au second cycle en Science Santé. Reinardus-le-goupil, étudiant à Polytechnique, est un athée explicite fraîchement islamisé pour fins maritales (il vient de convoler avec sa douce moitié). Quant à Ysengrimus, votre humble serviteur, il reste le modeste auteur de l’ouvrage L’Islam, et nous les athées, présentation critique de la culture musulmane ayant les occidentaux rationalistes pour lecteurs cibles. Reinardus-le-goupil me glisse à l’oreille, juste avant la levée du rideau: Ce sont mes beaux-parents qui m’ont recommandé ça… à cause de la similarité de situation entre le principal protagoniste et moi. Je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Si ça se trouve, c’est nul. La dent scintillante, je lui réponds: même nul, ça promet d’être sociologiquement hautement intéressant. Et le spectacle démarre.
Que dire. L’intention est bonne. L’effort est louable. L’écriture et la conception sentent un peu la lampe mais elles ne sont pas exemptes de mérites. La mise en scène est imaginative et enlevante et la distribution est parfaitement satisfaisante. Il y a incontestablement de bons moments et ce, tant pour les théâtreux que pour les philosophes (le quiz comparatif de l’image de la femme dans les grandes religions est dévastateur. Les numéros promo-gadget de l’historique du Frère André et de l’agence de voyage des pèlerinages sont savoureux). Malgré les réserves que je vais devoir malheureusement formuler, ce spectacle, marrant et —redisons-le— bien intentionné, vaut incontestablement le détour.
Jean-François (Jean-François Pronovost), québécois du cru, catholique non pratiquant et athée de fait, et sa conjointe Maryam (Sounia Balha), musulmane culturelle d’origine marocaine, attendent un bébé. Les voici donc qui jonglent, sans enthousiasme réel, avec l’idée de se marier. Se profilent alors deux univers. L’univers de la certitude contrite des obligations maritales, le papa (Belkacem Lahbaïri) et la maman (Nabila Ben Youssef) de Maryam. L’univers de l’aquoibonisme occidental en déréliction avancée quoiqu’incomplète, nommément le papa (Michel Laperrière), fidéiste vieux genre, et la maman (Marie Michaud) agnostique et cancéreuse, les parents divorcés de longue date de Jean-François. On nous sert alors le tourbillon habituel des comédies de boulevard, dans une version rencontre des cultures. Dans le contexte d’explosions émotives type des situations pré-maritales de tréteaux, tout le monde se met à débloquer et à se lancer dans les grandes mises au point champion d’usage. L’intensité joue d’excès. Le programme critique mobilise la caricature. C’est ici que le risque s’installe. Le beau risque? Voire. Le risque, en tout cas.
C’est que la caméra, la tête de lecture, est tenue par l’homme occidental. Lapidaire, Reinardus-le-goupil dira, un peu plus tard: ça reste un show de blancs. Et pourtant cette caméra, cette lecture, cette écriture se veulent équilibrées, symétriques et omniscientes. Qu’en est-il? De fait, le spectacle donne à voir une schématisation accusée de la culture québécoise, pognée entre ses références catholiques lourdingues et vieillottes et une déréliction aussi galopante que mal dominée. Ça ne passe pas toujours. C’est parfois trop gros. Mais Ysengrimus, 61 ans, sait faire jouer le filtre et ne craint pas de se faire fourguer, sur son propre bagage ethnologique, de la soupe de stéréotypes (sauf que, qu’en est-il de la perception de ses trois jeunes hôtes?). Et, d’autre part, on nous montre aussi, comme au premier degré, des femmes musulmanes entre elles (notamment pendant le hammam… ça, monsieur Boudreault, ça s’appelle une prosopopée et c’est toujours, oh, oh, hautement risqué), ou encore la famille musulmane (de souche marocaine) dans son intimité. Les débats y font rage. On découvre un univers tendre et intense mais dévoré par le conservatisme et ravaudé par les contraintes de conformité sociale. Un univers des apparences. Qui se soucie de la vérité? dira à Jean-François, son nouveau beau-père. Et Jean-François, poussant des rideaux pour tenter de voir sa promise en habit de mariée se fait gueuler dessus en arabe par des femmes que l’on ne voit pas. Qui sont-elles? Existent-elles réellement dans le monde réel, celui du réel?
Au sortir de la pièce, je me suis tourné vers la Dame à la Guitare et Clef de Sagesse et je leur ai dit directement: Mesdemoiselles, mon jugement final sur ce spectacle va dépendre de vous. Sur tout le segment concernant la culture musulmane, je suis totalement dans le noir. Que me sert-on ici exactement: du truculent ou du stéréotype? La réussite ou l’échec de ce genre d’exercice se joue sur ce point-là et sur aucun autre, dans mon regard. Car les hypertrophies caricaturales présentées au sujet de la culture québécoise, je sais parfaitement les discerner et les dominer. C’est le traitement de la culture musulmane qui est en jeu ici, pour moi. Sur toutes ces questions sensibles, je n’ai vraiment pas envie de me faire servir un Minstrel Show. Clef de Sagesse m’a alors demandé: Qu’est ce que c’est que ça? Ma réponse: Tu sais, une roulotte de saltimbanques où des acteurs noirs, ou pire des acteurs blancs peints en noir, sautillent et nous re-servent à nous blancs, la confirmation de nos stéréotypes de blancs sur les noirs. Le beau visage de Clef de Sagesse s’est alors rembruni.
Et mon échantillon sociologique s’est alors fragmenté. Sans hésiter, Clef de Sagesse annonce qu’elle considère que le traitement des principaux traits de la culture musulmane a été trivialisé, esquissé sur un ton toc, superficiel et exempt d’analyses effectives. Elle citera notamment l’explication que le père de Maryam produit de la signification du pèlerinage à la Mecque, ramené, assez grossièrement effectivement, à quelque chose qui coûte vachement cher et est donc sensé livrer une rédemption efficace et indubitable de tous les péchés, quelle que soit leur gravité. Le cheminement intérieur associé au pèlerinage et sa signification profonde sont perdus, dira Clef de Sagesse. Je me suis senti insultée. La Dame à la Guitare, plus critique de son héritage culturel, signalera quelques bons moments, notamment les engueulades anti-patriarcales de Maryam avec son papa. La Dame à la Guitare dira avoir eu mille fois ce genre d’empoigne avec son propre paternel. Mais elle rejoindra Clef de Sagesse sur le point du charriage et de la superficialité des comportements et des idées et déclarera, elle aussi, avoir senti qu’on se payait sa poire ou l’insultait un peu, par moments. Inutile de dire, les petits amis, que l’analyse de ces deux personnalités intelligentes et nuancées tue cette production raide à mes yeux. Il va sérieusement falloir revoir la copie, monsieur Boudreault. Les humains ne sont pas des marionnettes.
Reinardus-le-goupil n’est pas resté en retrait. Après tout, bondance, ceci est censé raconter son histoire, articuler son regard, du moins partiellement… Athée, bien athée, élevé dans un cadre athée (et certainement pas «non pratiquant» de quelque culte culturellement transmis que ce soit), mon goupil est resté insatisfait face à cette présentation tronquée et courtichette du jeune athée virulent et compulsif qui ne croit en rien (foutaise canonique sur l’athéisme), n’a pas fait la synthèse, et apparaît plus comme un iconoclaste mouche du coche picossant au talon les grandes religions plutôt que comme l’agent puissamment relativisant et historicisant qu’il est effectivement. Ici aussi, l’athée est caricaturé, trivialisé. Il est traité de façon grossière et simpliste. Il n’est pas analysé. Je seconde Reinardus-le-goupil entièrement sur ces points.
On s’efforce de renvoyer les religions dos à dos, en méthode, mais au bout du compte, c’est encore l’athéisme qui y perd. La Dame à la Guitare nous fournira la conclusion synthèse la plus juste. Le fait de caricaturer et de miser sur les effets dramatiques de l’excès a eu un coût pour tout le monde. Toutes les cultures se sont trouvées esquissées à gros traits et personne n’y a finalement vraiment trouvé son compte. Je donne 7/10 pour l’effort et les bonnes intentions mais je me demande quand même… à part m’avoir un petit peu amusé et diverti, qu’est ce que ce show m’apporte, au bout du compte?
Perso, je crois que ce show pétri de bonne conscience vise discrètement à rassurer les occidentaux (ici, les québécois) à propos des immigrants musulmans. Si vous allez voir cette pièce de théâtre, écoutez attentivement l’accent de Maryam. Cette jolie marocaine, très typée arabe (et jouée superbement), parle français comme une québécoise de souche. Elle a la langue d’une pure laine intégrale. Le message est bien là, latent, gentil-gentil, imperceptible mais net. Bien de chez nous, surtout. La superficialité en est la clef. Vous énervez pas trop le poil des jambes avec nos immigrants musulmans. Ils vont peut-être nous islamisouiller un peu, comme ça, à la surface des choses, pour rencontrer leurs propres contraintes de conformité ridicules et vieillottes… mais au fond, c’est nous qui allons bel et bien les assimiler, à la fin de la course. Écoutez et observez attentivement Maryam, la seule immigrante de seconde génération de tout cet opus, ce sera pour constater que c’est une québécoise, maritalement, comportementalement, idéologiquement et discursivement, pleinement convertie et que sa culture marocaine, elle n’en veut plus vraiment. Une autre victoire pour la bonne vieille ligne doctrinale du Théâtre du Rideau vert.
Mon échantillon sociologique, jeune, tonique, brillant, autonome et sourcilleux, ne rencontre ce programme que fort imparfaitement. Enfin, la barbe un peu aussi. Qui veut se faire assimiler, finalement? Pas les québécois ou les québécoises, en tout cas. Or, sur ce point, nous sommes TOUS ET TOUTES québécois et québécoises ici… Poils aux sourcils…
.
.
.
Paru aussi dans Les 7 du Québec
.
.
.
Posted in Civilisation du Nouveau Monde, Culture vernaculaire, Fiction, L'Islam et nous, Montréal, Multiculturalisme contemporain, Philosophie, Québec, Sexage, Vie politique ordinaire | Tagué: athéisme, Clef de Sagesse, Comment je suis devenu musulman, conformisme, femme, fiction, francophonie, homme, Islam, La Dame à la Guitare, Montréal, multiculturalisme, musulman, Philosophie, pièce de théâtre, Québec, Reinardus-le-goupil, religion, Simon Boudreault, théatre, Théâtre du Rideau vert | 15 Comments »